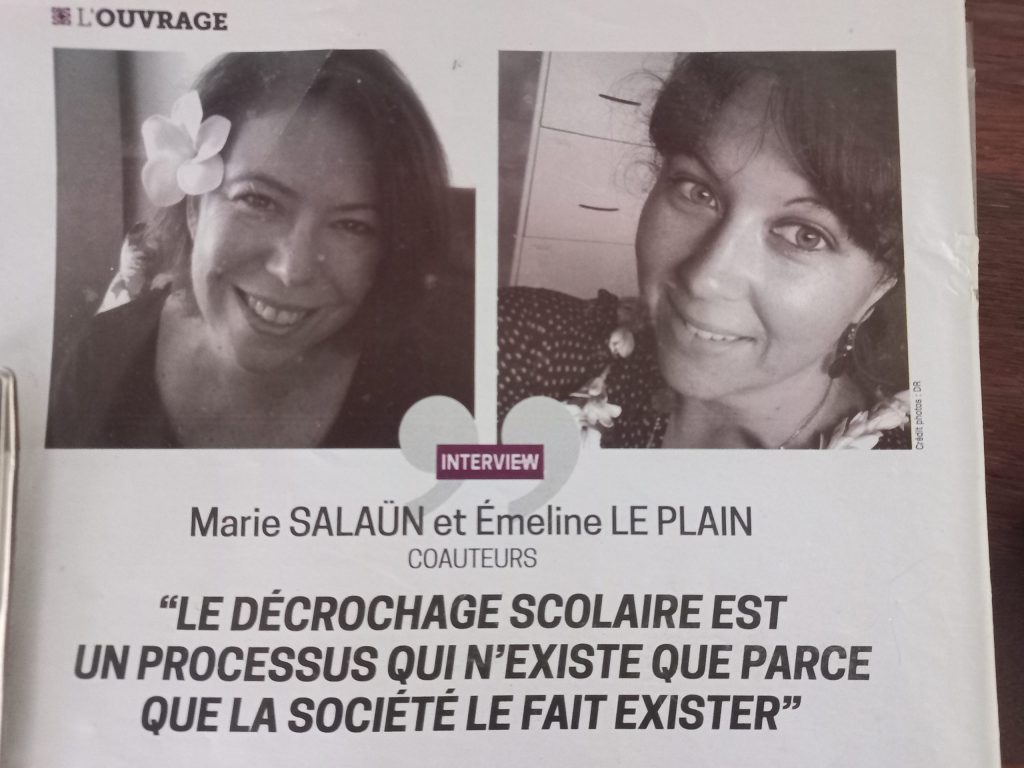
Tahiti Pacifique s’est intéressé à la publication de notre ouvrage. Nous avons répondu à une interview avec Marie, je vous livre mes réponses ici. Pour lire la totalité de l’article, vous avez le lien en bas de page.
Pourquoi avoir souhaité écrire ce livre ?
Lorsque Marie m’a proposé de co-écrire ce livre, j’ai tout de suite accepté, car cela correspondait à un versant de ma thèse. Je m’intéresse au décrochage scolaire en Polynésie française, dans un contexte postcolonial dont je me propose de mesurer l’influence. Mon entrée est double : j’enquête d’une part sur les relations entre l’école et les familles, et d’autre part sur la fonction du conseiller principal d’éducation.
Aller à la rencontre des familles sur le terrain, était l’occasion de quitter le côté institutionnel pour faire un pas de côté, comme le montre notre livre, en replaçant l’élève en situation de décrochage scolaire dans un parcours, une histoire singulière dont l’aboutissement a certes une traduction institutionnelle mais qui ne se limite pas à celle-ci. Ces entretiens ont eu pour but de mieux cerner la configuration familiale, pour contextualiser les expériences scolaires contemporaines des adolescents, les réinsérer dans une éventuelle trajectoire en questionnant la transmission d’un rapport à l’école spécifique de génération en génération. Derrière le mot défaillance, on peut lire certaines résistances.
Co-écrire ce livre était également pour moi, l’occasion de faire mes armes aux côtés de Marie, une anthropologue aguerrie, afin d’être prête à reconduire l’expérience mais cette fois, du côté des professionnels, plus particulièrement des conseillers principaux d’éducation (CPE) sur l’île de Tahiti et de Moorea ; concernant l’autre versant de ma thèse.
Quels constats faites-vous dans le milieu éducatif polynésien ?
Le constat est que, comme le titre de notre livre l’annonce, l’école est ambiguë autant pour les familles, que pour les professionnels, comme je l’ai découvert et l’écrit dans ma thèse.
L’institution scolaire engendre des comportements ambivalents dans les familles, entre la coopération et l’envie de tout envoyer valser, cahier, stylos, pas au sens figuré.
Ce qui est sûr, c’est que l’école en Polynésie française, n’est pas une école dans une belle carte postale comme le montre notre couverture. Il y a certes, l’existence de ce beau lagon, « ce bleu qui fait mal aux yeux » (A.Duprel, 1988) mais également ce côté montagne, noir, avec des difficultés loin de constituer une belle publicité.
Comme dans l’ensemble de l’outre-mer français, l’École est le « produit de la rencontre coloniale » (Salaün, 2013) et il est important de mesurer l’impact d’un tel poids historique afin de comprendre ce qui se joue aujourd’hui dans l’École. Jusqu’où l’autonomie en éducation est-elle appliquée ? Lorsque la politique éducative, de la maternelle au lycée, est une compétence d’attribution de la Polynésie française et que les postes clefs de la direction générale des enseignements et de l‘éducation (DGEE) sont occupés par d’anciens personnels de l’Éducation nationale d’abord mis à disposition de la Polynésie française, avant d’être détachés ensuite sur un emploi relevant de cette collectivité : on est en droit de se poser la question. Une synergie ambiguë, elle aussi.
Un fonctionnement ambiguë où un lien étroit est pratiqué entre l’identité et l’appartenance à une communauté par le professionnel et son type de contrat ; où seul son cercle de relation peut influer sur la tenue et la durée du contrat.
Le milieu éducatif polynésien porte en lui les stigmates de la colonisation, il faudra le redire, l’assimiler, pour le changer et avancer ; où le culturalisme ne sera plus une excuse pour expliquer tout et n’importe quoi dans l’espoir de trouver un ordre des choses plus facile à vivre.
Quelles ont été les difficultés majeures pour réaliser cet ouvrage ?
Il y en a eu plusieurs et c’est toujours difficile.
La première difficulté a été la correction du livre, avec la problématique de gérer une co-écriture à distance, avec tout ce que cela implique, le décalage horaire, la variabilité des connexions internet, cela n’a pas été simple. La seconde a été de se faire éditer sur le territoire polynésien, ce qui est regrettable. Nous aurions préféré présenter un livre local mais nous n’avons pas été respecté en tant qu’auteur. Nous avons dû repenser un titre et une couverture en urgence. Heureusement Marie avait une solution de repli. La troisième difficulté pour moi et qui perdure reste la diffusion. L’import de livre est fortement taxé sur le territoire, ce qui n’aide pas les librairies locales à diffuser facilement. Le livre est sorti en juin, je ne cesse de rencontrer des personnes soulignant l’intérêt de publier de tels témoignages et à la fois, dans toute sa contradiction, c’est très difficile d’en parler dans les médias.
Certains de nos lecteurs nous ont confiés ne pas avoir lu tous les témoignages, car trop douloureux. Je peux comprendre que cela bouleverse de lire de telles histoires de familles quand nous vivons dans notre propre quotidien, aussi loin de leur réalité. Cela peut bousculer, mais si le regard change, le pari est gagné. Mes collègues enseignants qui l’ont lu, ont estimé que chaque personnel arrivant devrait le lire, je l’espère mais ceux qui vivent ici, également, car je ne suis pas sûr que tous savent réellement ce qui se passe pour certains de nos élèves.
Les témoignages de parents d’élèves n’ont-ils pas été ardus à obtenir ?
Dans l’ensemble, je dirais non. Le projet est né à la fin, de ma première année en tant que CPE sur la presqu’ile de Tahiti. J’avais identifié sur mon année, 58 élèves en situation de décrochage scolaire, sur le niveau 4èmedont j’avais la responsabilité. Sur toute cette liste, j’ai dégagé une vingtaine de profils d’élèves présentant un fort taux d’absentéisme où différentes solutions ont été proposées aux familles. Et où le contact avait été bien établi, soit en les rencontrant au collège, soit en allant en mairie, ou en visite à domicile avec l’assistant social. J’ai recontacté ces familles au début de l’été 2015, au moment de la venue de Marie sur le territoire et nous avons pu concrétiser nos entretiens avec huit familles dont vous avez les témoignages dans le livre. La 9èmehistoire de famille est une famille que Marie a suivi dans le cadre d’autres recherches que je lui laisse le soin d’exposer.
Le décrochage scolaire est-il une fatalité selon vous ?
Le décrochage scolaire est un processus qui n’existe que parce que la société le fait exister. Sa construction est déterminée par les normes d’achèvement de la scolarité et du niveau de qualification correspondant. Si le territoire, l’Etat français, décidait demain qu’un élève peut sortir du système éducatif sans qualification, la notion de décrochage scolaire n’aurait plus lieu d’être. A contrario, si le but de la société demeure, de par son école, de dégager une élite tout en continuant à reproduire les inégalités sociales, alors oui, le décrochage scolaire devient une fatalité car la compétition construite au sein du système induit forcement de l’exclusion.
Un des dangers sur le territoire est de ne pas prendre en compte les inégalités sociales et l’immense fossé qui se creuse entre les différentes catégories socio-professionnelles et les communautés ; car on le sait le niveau de diplôme est fortement corrélé avec l’insertion sur le marché du travail.
Comme le montre le document de travail del’Agence française de développement (Herrera & Merceron, 2010) intitulé « Les approches de la pauvreté en Polynésie française », ils constatent par l’indice de Gini que la Polynésie française se rapproche davantage des pays latino-américains que de la métropole. En effet « Les 20% (le quintile) des ménages polynésiens les plus riches capte près de la moitié (47%) du revenu total des ménages, tandis que le quintile des ménages les plus pauvres en reçoit à peine 6%. »
Le décrochage scolaire n’est plus une fatalité si on lutte efficacement contre les facteurs qui l’engendrent car on sait identifier les élèves en voie de décrochage. Pour preuve, sur les 58 élèves en 4ème, du début de l’enquête, aucun n’a obtenu son DNB. On peut faire le pari que, bon nombre d’entre eux, malgré une affectation au lycée, ne sont pas allés au bout de leur scolarité et par conséquent n’ont pas obtenu une qualification et sont des décrocheurs.
Concernant les élèves interviewés dans le livre, seuls 2 élèves n’ont pas eu le titre de « décrocheurs » grâce à l’obtention de leur CAP. Pour eux, le parcours du combattant continue car la passerelle CAP- Bac Pro leur a été refusé. Seul un élève dont la mère est une combattantea réussi à trouver une place grâce à la Journée de la SIO proposée par le bureau de l’orientation à la DGEE.
Quels sont les moyens que vous envisageriez de mettre en place pour lutter contre l’exclusion scolaire ?
Il ne s’agit pas uniquement d’exclusion scolaire. Certains élèves sont en voie de décrochage et sont pourtant bien présents dans l’établissement scolaire. Pour répondre en termes de moyens, il faut connaître l’ambition et les attentes du pays vis-à-vis de l’École mais également vis à vis de sa Jeunesse, quel souhait fait-il pour l’ensemble de sa population en termes de conditions de vies ?
Notre ouvrage prône l’accès à la réalité du terrain afin de dégager des moyens qui collent à la réalité sans suivre systématiquement ce qui se fait en métropole. S’adapter à la réalité locale, c’est la clef. Et les recherches sur l’éducation en Polynésie française sont trop peu nombreuses.
Est-il si important de rattraper la moyenne nationale au baccalauréat quand on sait que tous les élèves polynésiens ne sont pas présentés à ce diplôme ?
Si on s’en tient à la mission du CPE, par exemple, qui est de « placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective et d’épanouissement personnel »
Cette mission est mis à mal par l’absence de structures, de relais, des aides nécessaires aux besoins de l’adolescent. Un adolescent fumeur de paka devrait pouvoir avoir accès aux soins facilement, tout comme, les élèves ayant besoin d’un suivi psychologique voir psychiatrique. Cet accès aux soins passe aussi par un système de transport adapté.
Ces histoires de familles font prendre conscience au lecteur qu’il existe sur le territoire tout un pan de la population qui n’a pas les moyens de répondre aux premiers besoins fondamentaux des adolescents, à savoir bien manger, dormir sous un toit, avoir accès aux soins sans tomber dans les stéréotypes culturalistes sur le parent défaillant. Dans notre livre, vous verrez des familles, des parents d’élèves décrocheurs, tout, sauf défaillant, qui font avec les moyens du bord, qui avancent, qui tentent de comprendre, qui résistent parfois à leurs façons.
Comme nous le disons dans notre conclusion, « Ils n’attendent ni compassion, ni paternalisme. Désirant être écoutés et traités en égaux, ils réclament à leur façon, parfois silencieuse, la bienveillance et le respect qu’une société juste devrait leur témoigner. »
Les efforts récents fait en direction du dialogue avec les familles ne doivent pas rester purement politique mais s’opérer dans toutes les strates des établissements scolaires.
Il faut encourager la relation de confiance entre l’école et les parents. Pour cela, il faut préciser les attentes des deux côtés, en jouant franc-jeu, et honnêteté en donnant les clefs du jeu scolaire à tous les parents sans jugement de valeur. (Métier d’élève, résultats aux évaluations, bulletins, orientation…) mais aussi en autorisant les professionnels de l’éducation à agir avec exigence et bienveillance, loin de tout laxisme. C’est également donner les moyens matériels aux établissements d’alerter, d’informer correctement les familles en impliquant le responsable légal ; mais aussi de permettre aux enseignants d’avoir les moyens matériels d’exercer et de s’adapter aux élèves ayant de plus en plus des besoins particuliers.
Il faut encourager les recherches dans le domaine de l’éducation et prendre en compte les recommandations de ces chercheurs. Je laisserai à Marie le soin de parler de l’importance de prendre en compte le plurilinguisme sans tomber dans l’excès du folklore.
Il existe une multitude de moyens à mettre en place, encore faut-il se donner les moyens de vouloir changer la réalité locale.
Quels sont vos prochains projets ?
Je souhaite terminer ma thèse et ainsi donner la parole aux professionnels de l’éducation, qui ont, autant besoin que les familles d’être entendues, et de comprendre au mieux la pièce de théâtre dans laquelle ils jouent.
Ma thèse s’intitule « Le modèle des conventions éducatives à l’épreuve d’un contexte postcolonial : la place du CPE dans la lutte contre le décrochage scolaire à Tahiti. », j’espère la soutenir dans le courant de l’année prochaine.
Quant à mon métier de conseillère principale d’éducation, je vais devoir le mettre de côté quelques temps puisque je n’ai pas obtenu le fameux graal, du CIMM (centre intérêt moraux et matériels) pour continuer à exercer ici. Tout comme les parents perdus face à l’institution scolaire, je ne connaissais pas toutes les règles du jeu en allant au tribunal administratif. J’ai perdu, je sais désormais comment obtenir légalement un CIMM lorsque l’on ne souhaite pas rentrer dans le jeu des cercles d’influence ; mais me séparer de mon conjoint, proposer une garde alternée pour nos filles, entre autres, pour rester exercer ici ne m’intéresse pas.
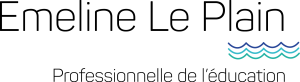
Vous trouverez l’intégralité de l’article en cliquant sur ce lien : https://www.tahiti-pacifique.com/Decrochage-scolaire-des-eleves-et-leurs-familles-liberent-leur-parole_a1202.html
Et pour lire et vous procurez notre livre, voici le lien : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60301


