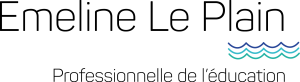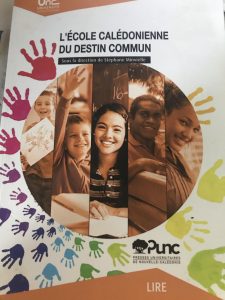
Cette communication a fait l’objet d’une publication dans les Actes de ce colloque. Vous trouverez les références en bas de pages.

Entre reproduction du modèle national et « autonomie » du pays : Quelques aspects de la gestion de la difficulté scolaire en Polynésie française.
A 18 000 kilomètres de Paris, la Polynésie française est constituée de 118 îles dispersées sur 5 millions de km2maritimes. Elle s’étire sur une surface aussi vaste que l’Europe. En 2012, le dernier recensement comptabilise 268 207 habitants répartis sur l’ensemble des cinq archipels. Cependant 75% des habitants se concentrent sur les îles du vent, dans l’archipel de la société, entre Tahiti et Moorea.
Si l’histoire coloniale qui la lie à la République française ne ressemble pas à celle de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française partage aujourd’hui avec cette collectivité un héritage qui mêle une grande diversité ethnique de sa population et de très fortes inégalités socio-économiques principalement entre quatre communautés : les Polynésiens qui représentaient en 1988, 82 % de la population, les Asiatiques (6%), les Européens ( 11% dont 98% de nationalité française) et les « demis » (issus de mariages mixtes) qui sont également représentés dans les trois premiers groupes ethniques (ITSTAT, 1988).
Ces inégalités ont été mesurées dans un document de travail de l’Agence française de développement (Herrera & Merceron, 2010) intitulé « Les approches de la pauvreté en Polynésie française ». En utilisant l’indice de Gini, ce document constate que la Polynésie française se rapproche davantage des pays latino-américains que de la métropole. En effet, « Les 20% (le quintile) des ménages polynésiens les plus riches capte près de la moitié (47%) du revenu total des ménages, tandis que le quintile des ménages les plus pauvres en reçoit à peine 6%, et que « la pauvreté est nettement plus élevé chez les ménages qui se ressentent « Maohi » (Polynésiens) que chez les « Popa’a » (Européens), cela provient pour l’essentiel de différentiels de niveaux de diplômes et d’insertion sur le marché du travail ».
Comme en Nouvelle-Calédonie, les fonctionnaires mis à disposition par l’Etat font partie des plus favorisés. Ils , bénéficient de traitements indexés qui s’élèvent, en moyenne, à trois fois le salaire minimum polynésien (149 491 fcp soit 1252 euros). Il n’est pas anodin de noter que le niveau de vie dont bénéficie le corps enseignant l’éloigne de factodes conditions dans lesquelles vivent de nombreuses familles polynésiennes.
Il existe également des différences entre les enseignants du premier et du second degré. Les premiers sont quasiment tous recrutés localement, tandis que les seconds sont à 50% des enseignants mis à disposition de la Polynésie française. L’autre moitié bénéficie de la reconnaissance de leur centre d’intérêt moral et matériel (CIMM) sur le territoire, ce qui les protège de la limitation de durée de séjour, qui est égal à deux ans renouvelable une fois en lien avec le décret de 1996.
L’institution scolaire y est pour ainsi dire calquée sur le modèle métropolitain : même organisation des examens mise à disposition d’enseignants du secondaire, diplôme nationaux, etc. Comme en Nouvelle-Calédonie, le système scolaire polynésien a été historiquement construit sur le modèle métropolitain avec une accélération de la mise en conformité de ce système après la Seconde Guerre mondiale (cf. chapitre de Marie Salaün dans ce volume). Par ailleurs, il se caractérise par l’aspect massif des inégalités scolaires, réalité que la plupart des diagnostics institutionnels expliquent par un « retard » de la Polynésie française par rapport à la métropole. Ainsi, le dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes estime-t-il que ses performances scolaires la situent au niveau de celles de la métropole il y a 20 ans (CTC, 2014). Le taux d’accès au baccalauréat général d’une classe d’âge (16, 5 %) est équivalent au niveau métropolitain de 1970.
D’après le recensement de 2012 : « plus de la moitié des enfants de moins de 18 ans vivent dans les familles dont le chef de ménage est employé ou ouvrier, un sur six vit dans une famille de retraité, ou sans activité professionnelle contre moins d’un sur dix en métropole et enfin un enfant sur quatre vit avec un parent cadre ou de profession intermédiaire, contre près d’un sur deux en métropole. »
[1]A l’entrée au collège, 53% des élèves sont issus de CSP défavorisées, une proportion qui atteint 90% dans certains établissements. En 2007, l’archipel a été qualifié par l’Inspection Générale de « vaste zone d’éducation prioritaire » (IGEN, 2007).
Les indicateurs convergent pour attester de l’ampleur de l’échec scolaire. Par exemple, les taux d’illettrisme recensés lors des Journées défense et citoyenneté (JDC anciennement JAPD) sont éloquents : alors qu’en métropole, les difficultés à l’écrit concernent 7 à 8 % de la population, ils se situent entre 40 et 41% en Polynésie française. De même, le nombre de sorties du système scolaire sans diplôme, ni qualification touche environ 2000 élèves, ce qui représente environ 30% des sortants, taux observé en métropole dans les années 80.
Ce taux est très éloigné de l’objectif fixé par la stratégie Lisbonne définie par le Conseil européen (2000) à savoir moins de 10%. Elle se donnait pour mission de réduire le nombre d’abandons et d’augmenter le niveau de qualification de la population en vue de la croissance économique européenne.
Comment peut on expliquer un si grand écart entre deux systèmes éducatifs pourtant structurellement si proches l’un de l’autre ?
Mon analyse propose de mettre au jour les tensions entre la nécessité de se conformer au modèle national et celle de s’adapter à des réalités locales très éloignées de celles pour lesquelles ce modèle a été et continue d’être pensé. Après un bref retour sur l’histoire du système éducatif local et un survol rapide de la littérature académique produite sur la Polynésie française, nous verrons concrètement comment dans le cadre d’un partage de compétences entre l’Etat et le Territoire, une partie de la difficulté scolaire est gérée.
Le système éducatif polynésien
Autant qu’il est possible de le savoir, avant l’arrivée des Européens qui débute à la fin du XVIIIème siècle, des lieux dédiés à la transmission étaient présents dans les villages de chaque district. On y enseignait l’art de la pêche, la rhétorique, la construction des pirogues, ou encore les conduites à tenir sur les marae, espaces sacrés. Ces écoles traditionnelles furent bousculées par l’arrivée des missionnaire protestants anglais de la London Missionary Society(1797) qui évangélisaient dans les langues locales (Peltzer, 1999).
En 1831, on dénombre une trentaine d’écoles missionnaires réparties sur le territoire, principalement sur l’île de Tahiti, les Îles sous-le-vent mais aussi les Australes et les Tuamotus. Par la suite, la France, souhaitant contrer l’influence britannique dans le Pacifique, imposa progressivement un protectorat (1842). Ce statut évolue en annexion (1880), et la Polynésie devient une colonie sous le nom des Etablissement français d’Océanie (EFO).
Une partie de la population, les ressortissants du royaume Pomare, se voit attribuer le bénéfice de la citoyenneté française par l’acte d’annexion. L’autre partie, à peut près équivalente en nombre, est considérée comme « sujets indigènes » de l’empire. Dans les faits, et en l’absence de possibilité d’exercer une véritable souveraineté populaire à partir de 1903, la distinction entre « sujets » et « citoyens » est peu opératoire. Il en va ainsi du domaine scolaire, car si le principe d’obligation est adopté localement en 1897, quinze ans après la métropole, il concerne de fait aussi bien les enfants des « citoyens » que ceux des « indigènes » et n’est que très partiellement respecté, puisqu’on peut estimer qu’à la veille du second conflit mondial, environ le quart de la population ne bénéficie pas de la scolarisation. Le clivage central est en fait celui qui oppose les écoles de la ville de Papeete, où sont scolarisés les enfants des fonctionnaires métropolitains et ceux des familles « demis » les plus fortunées, et qui, dotées d’enseignants français de métropole, appliquent les programmes en vigueur dans l’Hexagone, et le reste de la Polynésie, des districts ruraux de Tahiti aux tréfonds des vallées marquisiennes.
Devenus comme la Nouvelle-Calédonie, Territoire d’Outre mer (TOM) en 1946, les établissements français d’Océanie changent de nom en 1957 pour devenir la Polynésie française. La loi-cadre Deferre de 1956 accorde aux TOM une évolution vers l’autonomie par la création d’un conseil de gouvernement. Par le transfert de l’Etat au Territoire de la compétence de l’enseignement primaire et secondaire ainsi qu’en matière d’enseignements professionnel et technique, les établissements d’enseignements publics deviennent territoriaux.
Cependant l’Etat, à la demande de la représentation élue locale, conserve la compétence pour les programmes d’étude, les examens, les diplôme et la capacité requise pour enseigner. L’enseignement secondaire n’est créé qu’au début des années 1960, à la faveur des besoins des familles française venues travailler pour le Centre d’expérimentations nucléaires. C’est seulement en 1965 que le premier baccalauréat est organisé en Polynésie française.
Par ailleurs, l’Etat soutient la création de structures originale qui n’existe pas en métropole tel que les Centres d’Education aux Technologies adaptées au Développement (CETAD) en 1981.
En 1984, la Polynésie française dispose d’un statut d’autonomie interne puis obtient un statut d’autonomie en 2004, qui qualifie par la loi organique la Polynésie française de « Pays d’Outre-Mer au sein de la République »
Cette collectivité bénéficie donc d’une autonomie de plus en plus en large au niveau scolaire comme nous le montre le tableau, accessible dans les actes du colloque, présentant la répartition interne des compétences de la Polynésie française entre les organes du pays (Lechat & Argentin, 2011).
Après une première publication pionnière en 1975, sous l’égide de la Fédération des œuvres laïques (Barral, 1975), il faut attendre les années 1990 pour que le thème d’un « échec scolaire » des élèves polynésiens suscite l’intérêt.
On trouve tendanciellement deux orientations dans l’étiologie de l’échec scolaire tout comme en Nouvelle Calédonie (Salaün, 2005)
A une analyse que l’on pourrait qualifier de « culturaliste » s’oppose une explication qui met en avant la dimension socioéconomique. On peut éventuellement envisager une troisième orientation puisqu’on observe en surplomb un discours de l’institution scolaire elle-même, qui mêle les deux types d’analyses précités et aboutit au fait que les difficultés scolaires sont régulièrement imputées à des déterminants externes (notamment familiaux) et rarement venant de l’Ecole elle même.
Avec une orientation psychologique, Bertrand Troadec explique que si l’enfant polynésien ne réussit pas, c’est parce qu’il a développé « une cognition polynésienne » différente de celle de l’enfant métropolitain : « l’infériorité chronique de l’enfant tahitien par rapport à la norme occidentale tend à permettre d’affirmer que des conceptions spécifiques de la culture polynésienne résistent au phénomène d’acculturation » (Troadec, 1996, p. 60).
On retrouve ici le type d’analyse que Marie-Joëlle Dardelin a développé pour la Nouvelle Calédonie (1984).
Pour sa part, Bernard Poirine explique, depuis une perspective socio-économique, que cette analyse lui fait minimiser le fait que la compétition scolaire n’est pas vécue de la même façon par tous les élèves polynésiens. Par ailleurs, il insiste davantage sur l’importance des catégories socioprofessionnelles des familles plus que sur leur « appartenance culturelle » ou ethnicité (Poirine, 1996). On est ici proche des analyses développées par Kohler et Wacquant pour la Nouvelle-Calédonie (1985).
Même si cette étiologie de l’échec scolaire est pour partie commune avec celle développée en Nouvelle Calédonie, de par leur histoire, ces deux territoires ne portent pas le même héritage. En effet, là où la Nouvelle-Calédonie a subi une colonie de peuplement et a connu une ségrégation scolaire forte avec des écoles spécifiques pour les indigènes (cf. chapitre de Salaün dans ce volume), les Polynésiens sont toujours restés majoritaires dans la population (80% aujourd’hui), et on a constaté dès les premières décennies de la colonisation l’émergence d’une classe dominante métisse, les Demis. Si elle n’est pas institutionnalisée comme dans la Nouvelle-Calédonie coloniale, la ségrégation scolaire est pourtant une réalité des EFO avec un premier clivage entre les ruraux et les urbains, et un deuxième clivage entre Tahiti et le reste des îles. Cette réalité inscrit le système scolaire dans « une relation duale : celui des élèves des archipels éloignés et celui des élèves des îles de la société » En effet, selon la zone géographique, il existe ou non des établissements du second degré, une répartition selon la densité scolaire a été privilégié. « Lorsque la logique d’implantation confinait à l’absurde, avec des écoles ne comptant qu’une classe de moins de 10 élèves ou des collèges de moins de 200 élèves, a été privilégiée, en substitution, l’organisation d’hébergements et de transports scolaires inter-îles par voies maritime et aérienne. » (CTC, 2014)
Ce déterminisme géographique représente 1,6 % du budget du système éducatif soit 1,053 milliards FCP afin que les élèves puissent bénéficier d’une prise en charge des transports qu’ils soient terrestres, maritimes ou aériens.
La totalité des dépenses du système éducatif polynésien s’élèvent à 65 milliards FCP en 2012 contre 52 milliards FCP en 2004. (CTC,2014)
Dans le cadre des lois d’autonomie qui se succèdent depuis la fin des années 1970, des adaptations, restreintes, ont concerné certaines disciplines scolaires, avec, par exemple, l’introduction dans l’horaire normale des écoles maternelles et primaires (donc à titre obligatoire…) d’un enseignement Langues et culture polynésienne (cf. l’article de Jacques Vernaudon dans ce volume).
D’autres adaptations ont été mises en œuvre comme la création de structures originales afin de répondre au plus près aux difficultés de certains élèves par la création de CETAD ou de CJA.
Ces adaptations, qui concernent l’ensemble des élèves, ne suffisent pas à pallier un déterminisme géographique, lui-même lié au déterminisme social.
La dispersion de l’habitat entre des archipels éloignés les uns des autres s’accompagne, dans un contexte de scolarité obligatoire, de considérables difficultés de transport. Elle engendre également un nomadisme scolaire qui devient une cause d’échec scolaire. Les élèves sont contraints de se déplacer dans la famille élargie ou en internat afin de se rapprocher au plus près des écoles. Les conditions de scolarité de ces élèves sont particulièrement difficiles. Plus la scolarité s’allonge plus le déplacement est long pour les élèves des îles.
Afin de retarder la séparation avec les parents, des groupements d’observations dispersés (GOD) existent, rappelant les classes uniques en métropole, où tous les niveaux sont présents dans une même classe. L’isolement géographique touche également les enseignants, qui, depuis le développement du système scolaire, ne se pressent pas en masse pour demander les affectations les plus éloignées de Tahiti. Cela a pu conduire à recruter des personnels qui ne satisfaisaient pas aux exigences en termes de titres universitaires, environ 30% des enseignants recrutés sans le baccalauréat (CTC, 2014) ; et aujourd’hui encore, certaines circonscriptions héberge un pourcentage très conséquent d’enseignants non titulaires : « cette situation a cependant conduit à maintenir devant les élèves les plus éloignés des exigences scolaires, les enseignants les moins instruits et les moins formés » (CTC 2014).
Le partage des compétences entre l’Etat et le Territoire
La gouvernance du système éducatif polynésien repose sur un mode partenarial entre l’Etat et le territoire régi par la convention du 4 avril 2007 lié à la la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Différentes conventions se sont succédées, avec pour but de notifier la répartition des compétences entre l’Etat et le territoire car les compétences ne sont pas toutes transférées.
Si un statut « d’autonomie » a été reconnu à la Polynésie française en 1984, le transfert de la compétence éducative avait été rendu possible dès 1957 (au primaire) dans un premier temps, puis au secondaire (1987) par la suite. L’Etat reste garant des diplômes nationaux.
En tant que principal financeur, L’Etat, représenté par le Vice-Recteur, met à disposition 92% des moyens humains et matériels afin de répondre au mieux à la Constitution qui prévoit « l’égal accès de l’enfant (et de l’adulte) à l’instruction » sur l’ensemble du territoire de la République. La majorité des enseignants exercent selon le principe d’une Mise à Disposition (MAD) pour la Polynésie française. Ces personnels sont sélectionnés sur dossiers à travers leurs parcours, leurs compétences et sont affectés par le ministre polynésien sur un établissement scolaire territorial. `
Une fois, les candidats sélectionnés, ils ne bénéficient que d’une seule journée de formation afin de contextualiser leurs enseignements. Parfois, cette dernière a lieu alors que certains ne sont pas encore arrivés en Polynésie. L’adaptation se veut rapide avec pour rappel que la loi est la même pour tous, étant donné que la République est une et indivisible. Cependant, exercer en Polynésie française nécessite quelques ajustements pour un fonctionnaire métropolitain, car il existe des différences juridiques entre ces deux systèmes.
En effet, toutes les lois votées en métropole ne sont pas répercutées automatiquement en Polynésie française.Pour ce faire, certaines doivent être adopté par l’assemblée territoriale. I
Les acteurs de la communauté éducative doivent être informés de ces différences d’applications ; e qui est plus facile depuis l’entrée en vigueur du code de l’éducation pour la Polynésie française (2015).
Auparavant, le flou juridique engendrait quelques incompréhensions, comme nous le raconte, Marc Debene, en préface de ce code : « « Ainsi a t’on pu dans certains établissements publics polynésiens rappeler l’interdiction du port des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse alors que la loi du 15 mars 2004 (Art. L. 141-5-1 du Code de l’éducation) n’a pas étendue à la Polynésie française (Art.L.163-1 ne le mentionne pas !). »
En outre, le territoire dispose d’un ministre de l’Education polynésien, et les services de l’éducation se trouvent au sein de la Direction Générale de l’Education et des enseignements (DGEE). Depuis juin 2004, cette nouvelle entité rassemble la Division de l’enseignement secondaire (crée en 1987) et la Division de l’enseignement primaire (crée en 2001) Cette fusion permet la prise en charge de l’entretien des bâtiments scolaires, des bourses, des allocations d’études, du transport avec l’aide des communes mais également des questions relatives au domaine du numérique, de la vie scolaire, de l’orientation et de l’insertion ou encore de l’action pédagogique et éducative.
Cependant concernant le second degré, l’Etat s’est engagé à travers la convention du 4 avril 2007 à participer aux constructions scolaires nécessaire afin de « désengorger » certains établissements qui subissent une surpopulation d’élèves. Un bon exemple est le collège de Taravao situé sur la Presqu’île de Tahiti, soit à 55 kms de Papeete. Il a été conçu pour accueillir entre 600 et 700 élèves et il en reçoit 1300. Après plusieurs faux départs, un nouveau collège est en construction à Mataiea, afin de pouvoir le désengorger ainsi que celui de Papara.
Le pilotage pédagogique est compliqué par l’éloignement de certains IA-IPR, qui résident en Nouvelle-Calédonie. Les inspections se limitent par conséquent à des missions entre 15 et 20 jours, deux à trois fois par an lorsque cela est possible.
La relation partenariale avec l’Etat repose sur une communication, qui a par le passé, parfois fait défaut. En outre, celle-ci a été plusieurs fois conflictuelle suite à un manque de transparence de la part de la collectivité de la Polynésie sur la tenue des comptes. Il n’existe aucun comité de suivi, et par conséquent, il est difficile de chiffrer le bilan des opérations. Comme le souligne la chambre territoriale des comptes « L’opacité des relations financières a mis à mal le fondement du partenariat » (CTC,2014).
Cette relation est également compliquée par ce qui est perçu, depuis la métropole, comme un « manque d’efficience ». Les résultats scolaires ne sont pas à la hauteur des moyens alloués par l’Etat.
« La dépense scolaire par élève était, en 2014, respectivement de 8.223 euros en Polynésie française et de 10.539 euros en Nouvelle-Calédonie, contre 7.700 euros en 2013 (dernier chiffre connu) pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer », constate la cour des comptes (2015) Même si les moyens mis en oeuvre « ont permis des progrès », avec notamment la progression du nombre de bacheliers, « les résultats restent en deçà des références métropolitaines ». Environ 35% des élèves de Polynésie et 20% de ceux de Nouvelle-Calédonie sortent encore du système sans diplôme ni qualification « contre environ 10% en métropole » (CTC, 2015).
Le coût et les performances métropolitaines restent l’étalon à l’aune duquel se mesure le rendement scolaire.Toutefois, l’Etat a cependant accepté certaines adaptations locales, encourageant la création de dispositifs propre à la Polynésie française. L’objectif est de réduire le nombres d’abandons et d’augmenter le niveau de qualifications de la population en vue de la croissance économique, avec la proposition d’un enseignement professionnel dans une structure spécifique à la Polynésie française : les Centres d’éducation aux technologies appropriées au Développement (CETAD) que nous allons maintenant présenter.

Les Centres d’éducation aux technologies appropriées au développement (CETAD)
Les Centres de jeunes adolescents (CJA)
Structures spécifiques ou gestion de la difficulté scolaire ?
Les CETAD sont des structures éducatives professionnelles implantées géographiquement sur le site d’un collège ou d’un lycée. Ils sont donc placés sous l’autorité du chef d’établissement avec un professeur détaché quelques heures pour en assurer la coordination. Tous les collèges ne sont pas pourvus de CETAD. Il en existe 12 réparties sur les cinq archipels, qui scolarisent environ un millier d’élèves. Cette structure ne remplace pas les Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, (SEGPA), qui sont présentes dans certains établissements scolaires du territoire.
Les CETAD ont été crée en 1981 pour former des ouvriers polyvalents semi-qualifiés par l’obtention d’un CAP-D (Certificat d’aptitude au développement), l’objectif étant également de « bien vivre dans les iles éloignés » (CTC, 2014). Ce sont les ateliers complémentaires des collèges qui ont été transformés en ateliers polyvalents. Ils ont été adaptés aux exigences économiques locales et aux conditions sociale et culturelle des adolescents polynésiens. Il s’agissait d’offrir à des élèves éloignés une formation qualifiante nécessaire afin de pouvoir rester dans leurs archipels si tel est leur désir.
En 1983, des filières spécifiques comme la construction et l’entretien des bâtiments (CEB), ainsi que l’activité familiale artisanale et touristiques (AFAT) ont été ouvertes. En 1988, ce sont les filières de gestion et entretien en milieu marin (GEMM) et gestion et entretien de la petite exploitation rurale (GPER) qui viennent compléter l’offre de formation dans les CETAD.
Les élèves y ont accès à la fin de la 5ème, niveau considéré comme un palier d’orientation jusqu’en 2016. A l’origine, le CETAD dispensait deux années de formation, portées aujourd’hui à trois ans après la 5e. A la fin du cursus, les élèves passent le diplôme national du brevet professionnel en vue d’intégrer un lycée professionnel ainsi que CAP-D, qu’ils peuvent utiliser lors de leur entrée dans la vie active.
Cette structure permet aux élèves en difficulté, d’appréhender une autre façon d’apprendre en alliant théorie et pratique, avec pour certains une projection professionnelle.
Malheureusement le recrutement de ces élèves se faisait à partir de leurs difficultés en mathématiques et en français ; ce qui entrainait par la suite un faible taux de réussite aux diplômes du fait de la faiblesse des compétences acquises dans les matières disciplinaires « En effet, sur les élèves de 6èmedécelés avec des difficultés en français et en maths soit environ 50% des élèves, beaucoup, sinon tous intègrent la voie professionnelle ».(p. 93, CTC, 2014).
Par ailleurs, le CETAD a été utilisé pour des élèves en mal de repères, pour lesquels l’enseignement pratique permettait de redonner du sens à une théorie devenue trop abstraite. Ainsi, il a pu remédier à certaines situations d’absentéisme. Ces élèves ne sont pas pour autant sortis de l’enceinte de l’établissement scolaire puisqu’ils bénéficient que les collégiens ou lycéens : même règlement intérieur, sauf en lycée où l’âge entre en ligne de compte, même temps de vie scolaire et d’études partagés, ateliers sur le site du collège ou du lycée. La différence avec le collège se trouve dans la notation, puisqu’elle passe par des codes couleurs se rapprochant davantage de l’évaluation en primaire : vert pour les compétences acquises, rouge pour celles non acquises.
Cette structure a été créée afin de répondre à la scolarisation des élèves des îles et a connu comme dérive de traiter principalement la difficulté scolaire. L’Etat a soutenu ce projet jusqu’à cette année (2016) où par la réforme du collège, le recrutement au CETAD en fin de 5èmeprends fin. Il aura désormais lieu après la 3ème.
Parallèlement à cette structure, le territoire a soutenu la création des Centres de jeunes adolescents (CJA) en 1978. Ils ont d’abord été créés à titre expérimental pour ensuite se multiplier dans les années 80, soit en même temps que les CETAD. Une rivalité est apparue entre ces deux structures. Les CJA ont été accusés de n’apporter aucune valorisation et formation professionnelle contrairement à l’enseignement proposé dans les CETAD, le but recherché n’étant pas le même. Ces structures ont été créées pour répondre à la demande d’occupation des jeunes de 14 ans, non soumis à l’obligation scolaire et ayant échoué au certificat d’études. Leur objectif était de réinsérer ces jeunes souvent en échec par la formation à une économie de subsistance. A travers des formations très genrées, les filles pratiquaient la couture, et la cuisine tandis que les garçons faisaient de l’agriculture et de la mécanique.
Malgré leurs divergences, ces deux structures se complètent et sont devenus des partenaires de la réussite éducative où le jeune redevient acteur de sa scolarité. En parallèle, la plateforme proposée par l’Education Nationale en métropole telle que la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) a connu quelques adaptations mais a le mérite d’exister sur le territoire, au sein de la DGEE. Elle vise à réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans diplôme dès le primaire, et à prendre en charge les élèves décrocheurs (âgés de plus de 16 ans) en vue d’un raccrochage et/ou d’une qualification reconnue, pour une insertion sociale et professionnelle durable.
Cependant la réforme du collège a commencé à transformer le paysage de ces deux structures locales. Du fait d’une réticence des autorités locales à faire disparaître les CETAD par crainte d’une hausse des élèves absentéistes, ils évoluent à la rentrée 2016. La collectivité de la Polynésie rappelle que « la suppression des CETAD aurait des effets catastrophiques immédiats en terme de décrochage scolaire » (CTC 2014).
Le pallier d’orientation en fin de 5èmedisparaît pour laisser place à un recrutement en fin de 3èmece qui rapproche davantage les CETAD des antennes de lycées professionnels existant en Nouvelle-Calédonie. La rénovation de cette structure spécifique à la Polynésie tient également en compte l’évolution du niveau de qualification des élèves. Auparavant le CAP-D n’était pas reconnu par l’Etat au niveau V ce qui contribuait à dire que les élèves de CETAD étaient des décrocheurs au sens même de la loi de 2009, qui concerne « les anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire ».
Aujourd’hui, une question est de savoir quel CAP ces structures vont proposer. Est-il possible de conserver le caractère polyvalent de l’éventail des formations ? L’Etat va-t-il reconnaître ce diplôme ? Quelle différence existe-t-il avec les lycées professionnels ? Des passerelles sont-elles envisageables ou une hiérarchisation des structures va-t-elle s’imposer ? Les structures sont-elles en capacité matérielle de faire face à ce changement et de répondre ainsi aux exigences nationales ? Le diplôme proposé aura t’il une meilleure reconnaissance du CAP-D sur le marché du travail polynésien ?
Le territoire a suivi également la réforme du collège pour inclure davantage les CJA dans le système éducatif polynésien. Ils proposeront désormais différents parcours sous forme de modules adaptés à la difficulté de l’élève dans le but d’une réinsertion dans le système traditionnel classique, se rapprochant ainsi des classes relais en métropole. La réforme du collège va-t-elle pouvoir proposer des temps en ateliers professionnels afin de répondre à la demande de certains élèves d’être davantage en pratique ? Va-t-elle réussir à corriger les carences du primaire comme le soulignait le rapport de la Chambre territoriale des comptes ?
Conclusion
La difficulté scolaire en Polynésie est une réalité, liée à un déterminisme géographique et social mais aussi à son histoire scolaire récente. Historiquement, elle a été contrainte d’adopter le système éducatif métropolitain, au travers des partages de compétences elle a fait le choix de poursuivre sur cette voie avec le maintien des programmes nationaux destiné à atteindre l’objectif la réussite aux diplômes nationaux.
Malgré la crise de l’école en Polynésie française, l’éducation prioritaire n’a pas été un impératif pour le territoire pendant plus de vingt ans. Quelques adaptations locales ont été possibles et l’Etat a soutenu la création de structures originales que sont les CETAD et le CJA. Toutefois faute de résultats convaincants,(le nombre d’élèves ne fait que chuter) l’originalité de ces structures s’estompe avec la mise en œuvre de la réforme du collège applicable en Polynésie française à la rentrée d’août 2016.
Le système éducatif polynésien s’adapte et rénove ces structures afin de favoriser une réussite des élèves polynésiens reconnue au niveau national et répondant par ailleurs, aux exigences européennes. La question est de savoir si ces rénovations vont être l’occasion d’adapter la réforme des collèges au contexte polynésien ?
La valorisation des ateliers au CETAD permettra t’elle d’appliquer les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) ?
Aujourd’hui, le gouvernement semble à l’écoute de la jeunesse, avec par exemple, l’organisation des États généraux ou encore des Assises de la jeunesse (2016). Ces initiatives sont appréciées par les jeunes qui souhaitent participer à l’élaboration de la nouvelle Charte de l’éducation. Ils ont notamment demandé une meilleure valorisation de la culture locale.
Comme dans l’ensemble de l’outre-mer français, l’École est le « produit de la rencontre coloniale » (Salaün, 2013) L’important est donc de trouver un consensus politique grâce auquel elle n’est pas pris en otage, permettant ainsi d’avancer vers un destin commun, celui de la réussite de tous les élèves.
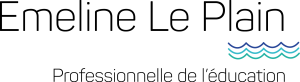
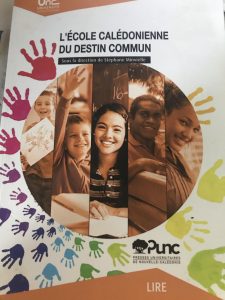
Participation et communication au colloque L’école calédonienne du destin commun à Nouméa en octobre 2016. Cette communication a fait l’objet d’une publication dans les Actes de ce colloque. Vous trouverez les références en bas de pages.

Entre reproduction du modèle national et « autonomie » du pays : Quelques aspects de la gestion de la difficulté scolaire en Polynésie française.
A 18 000 kilomètres de Paris, la Polynésie française est constituée de 118 îles dispersées sur 5 millions de km2maritimes. Elle s’étire sur une surface aussi vaste que l’Europe. En 2012, le dernier recensement comptabilise 268 207 habitants répartis sur l’ensemble des cinq archipels. Cependant 75% des habitants se concentrent sur les îles du vent, dans l’archipel de la société, entre Tahiti et Moorea.
Si l’histoire coloniale qui la lie à la République française ne ressemble pas à celle de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française partage aujourd’hui avec cette collectivité un héritage qui mêle une grande diversité ethnique de sa population et de très fortes inégalités socio-économiques principalement entre quatre communautés : les Polynésiens qui représentaient en 1988, 82 % de la population, les Asiatiques (6%), les Européens ( 11% dont 98% de nationalité française) et les « demis » (issus de mariages mixtes) qui sont également représentés dans les trois premiers groupes ethniques (ITSTAT, 1988).
Ces inégalités ont été mesurées dans un document de travail de l’Agence française de développement (Herrera & Merceron, 2010) intitulé « Les approches de la pauvreté en Polynésie française ». En utilisant l’indice de Gini, ce document constate que la Polynésie française se rapproche davantage des pays latino-américains que de la métropole. En effet, « Les 20% (le quintile) des ménages polynésiens les plus riches capte près de la moitié (47%) du revenu total des ménages, tandis que le quintile des ménages les plus pauvres en reçoit à peine 6%, et que « la pauvreté est nettement plus élevé chez les ménages qui se ressentent « Maohi » (Polynésiens) que chez les « Popa’a » (Européens), cela provient pour l’essentiel de différentiels de niveaux de diplômes et d’insertion sur le marché du travail ».
Comme en Nouvelle-Calédonie, les fonctionnaires mis à disposition par l’Etat font partie des plus favorisés. Ils , bénéficient de traitements indexés qui s’élèvent, en moyenne, à trois fois le salaire minimum polynésien (149 491 fcp soit 1252 euros). Il n’est pas anodin de noter que le niveau de vie dont bénéficie le corps enseignant l’éloigne de factodes conditions dans lesquelles vivent de nombreuses familles polynésiennes.
Il existe également des différences entre les enseignants du premier et du second degré. Les premiers sont quasiment tous recrutés localement, tandis que les seconds sont à 50% des enseignants mis à disposition de la Polynésie française. L’autre moitié bénéficie de la reconnaissance de leur centre d’intérêt moral et matériel (CIMM) sur le territoire, ce qui les protège de la limitation de durée de séjour, qui est égal à deux ans renouvelable une fois en lien avec le décret de 1996.
L’institution scolaire y est pour ainsi dire calquée sur le modèle métropolitain : même organisation des examens mise à disposition d’enseignants du secondaire, diplôme nationaux, etc. Comme en Nouvelle-Calédonie, le système scolaire polynésien a été historiquement construit sur le modèle métropolitain avec une accélération de la mise en conformité de ce système après la Seconde Guerre mondiale (cf. chapitre de Marie Salaün dans ce volume). Par ailleurs, il se caractérise par l’aspect massif des inégalités scolaires, réalité que la plupart des diagnostics institutionnels expliquent par un « retard » de la Polynésie française par rapport à la métropole. Ainsi, le dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes estime-t-il que ses performances scolaires la situent au niveau de celles de la métropole il y a 20 ans (CTC, 2014). Le taux d’accès au baccalauréat général d’une classe d’âge (16, 5 %) est équivalent au niveau métropolitain de 1970.
D’après le recensement de 2012 : « plus de la moitié des enfants de moins de 18 ans vivent dans les familles dont le chef de ménage est employé ou ouvrier, un sur six vit dans une famille de retraité, ou sans activité professionnelle contre moins d’un sur dix en métropole et enfin un enfant sur quatre vit avec un parent cadre ou de profession intermédiaire, contre près d’un sur deux en métropole. »
[1]A l’entrée au collège, 53% des élèves sont issus de CSP défavorisées, une proportion qui atteint 90% dans certains établissements. En 2007, l’archipel a été qualifié par l’Inspection Générale de « vaste zone d’éducation prioritaire » (IGEN, 2007).
Les indicateurs convergent pour attester de l’ampleur de l’échec scolaire. Par exemple, les taux d’illettrisme recensés lors des Journées défense et citoyenneté (JDC anciennement JAPD) sont éloquents : alors qu’en métropole, les difficultés à l’écrit concernent 7 à 8 % de la population, ils se situent entre 40 et 41% en Polynésie française. De même, le nombre de sorties du système scolaire sans diplôme, ni qualification touche environ 2000 élèves, ce qui représente environ 30% des sortants, taux observé en métropole dans les années 80.
Ce taux est très éloigné de l’objectif fixé par la stratégie Lisbonne définie par le Conseil européen (2000) à savoir moins de 10%. Elle se donnait pour mission de réduire le nombre d’abandons et d’augmenter le niveau de qualification de la population en vue de la croissance économique européenne.
Comment peut on expliquer un si grand écart entre deux systèmes éducatifs pourtant structurellement si proches l’un de l’autre ?
Mon analyse propose de mettre au jour les tensions entre la nécessité de se conformer au modèle national et celle de s’adapter à des réalités locales très éloignées de celles pour lesquelles ce modèle a été et continue d’être pensé. Après un bref retour sur l’histoire du système éducatif local et un survol rapide de la littérature académique produite sur la Polynésie française, nous verrons concrètement comment dans le cadre d’un partage de compétences entre l’Etat et le Territoire, une partie de la difficulté scolaire est gérée.
Le système éducatif polynésien
Autant qu’il est possible de le savoir, avant l’arrivée des Européens qui débute à la fin du XVIIIème siècle, des lieux dédiés à la transmission étaient présents dans les villages de chaque district. On y enseignait l’art de la pêche, la rhétorique, la construction des pirogues, ou encore les conduites à tenir sur les marae, espaces sacrés. Ces écoles traditionnelles furent bousculées par l’arrivée des missionnaire protestants anglais de la London Missionary Society(1797) qui évangélisaient dans les langues locales (Peltzer, 1999).
En 1831, on dénombre une trentaine d’écoles missionnaires réparties sur le territoire, principalement sur l’île de Tahiti, les Îles sous-le-vent mais aussi les Australes et les Tuamotus. Par la suite, la France, souhaitant contrer l’influence britannique dans le Pacifique, imposa progressivement un protectorat (1842). Ce statut évolue en annexion (1880), et la Polynésie devient une colonie sous le nom des Etablissement français d’Océanie (EFO).
Une partie de la population, les ressortissants du royaume Pomare, se voit attribuer le bénéfice de la citoyenneté française par l’acte d’annexion. L’autre partie, à peut près équivalente en nombre, est considérée comme « sujets indigènes » de l’empire. Dans les faits, et en l’absence de possibilité d’exercer une véritable souveraineté populaire à partir de 1903, la distinction entre « sujets » et « citoyens » est peu opératoire. Il en va ainsi du domaine scolaire, car si le principe d’obligation est adopté localement en 1897, quinze ans après la métropole, il concerne de fait aussi bien les enfants des « citoyens » que ceux des « indigènes » et n’est que très partiellement respecté, puisqu’on peut estimer qu’à la veille du second conflit mondial, environ le quart de la population ne bénéficie pas de la scolarisation. Le clivage central est en fait celui qui oppose les écoles de la ville de Papeete, où sont scolarisés les enfants des fonctionnaires métropolitains et ceux des familles « demis » les plus fortunées, et qui, dotées d’enseignants français de métropole, appliquent les programmes en vigueur dans l’Hexagone, et le reste de la Polynésie, des districts ruraux de Tahiti aux tréfonds des vallées marquisiennes.
Devenus comme la Nouvelle-Calédonie, Territoire d’Outre mer (TOM) en 1946, les établissements français d’Océanie changent de nom en 1957 pour devenir la Polynésie française. La loi-cadre Deferre de 1956 accorde aux TOM une évolution vers l’autonomie par la création d’un conseil de gouvernement. Par le transfert de l’Etat au Territoire de la compétence de l’enseignement primaire et secondaire ainsi qu’en matière d’enseignements professionnel et technique, les établissements d’enseignements publics deviennent territoriaux.
Cependant l’Etat, à la demande de la représentation élue locale, conserve la compétence pour les programmes d’étude, les examens, les diplôme et la capacité requise pour enseigner. L’enseignement secondaire n’est créé qu’au début des années 1960, à la faveur des besoins des familles française venues travailler pour le Centre d’expérimentations nucléaires. C’est seulement en 1965 que le premier baccalauréat est organisé en Polynésie française.
Par ailleurs, l’Etat soutient la création de structures originale qui n’existe pas en métropole tel que les Centres d’Education aux Technologies adaptées au Développement (CETAD) en 1981.
En 1984, la Polynésie française dispose d’un statut d’autonomie interne puis obtient un statut d’autonomie en 2004, qui qualifie par la loi organique la Polynésie française de « Pays d’Outre-Mer au sein de la République »
Cette collectivité bénéficie donc d’une autonomie de plus en plus en large au niveau scolaire comme nous le montre le tableau, accessible dans les actes du colloque, présentant la répartition interne des compétences de la Polynésie française entre les organes du pays (Lechat & Argentin, 2011).
Après une première publication pionnière en 1975, sous l’égide de la Fédération des œuvres laïques (Barral, 1975), il faut attendre les années 1990 pour que le thème d’un « échec scolaire » des élèves polynésiens suscite l’intérêt.
On trouve tendanciellement deux orientations dans l’étiologie de l’échec scolaire tout comme en Nouvelle Calédonie (Salaün, 2005)
A une analyse que l’on pourrait qualifier de « culturaliste » s’oppose une explication qui met en avant la dimension socioéconomique. On peut éventuellement envisager une troisième orientation puisqu’on observe en surplomb un discours de l’institution scolaire elle-même, qui mêle les deux types d’analyses précités et aboutit au fait que les difficultés scolaires sont régulièrement imputées à des déterminants externes (notamment familiaux) et rarement venant de l’Ecole elle même.
Avec une orientation psychologique, Bertrand Troadec explique que si l’enfant polynésien ne réussit pas, c’est parce qu’il a développé « une cognition polynésienne » différente de celle de l’enfant métropolitain : « l’infériorité chronique de l’enfant tahitien par rapport à la norme occidentale tend à permettre d’affirmer que des conceptions spécifiques de la culture polynésienne résistent au phénomène d’acculturation » (Troadec, 1996, p. 60).
On retrouve ici le type d’analyse que Marie-Joëlle Dardelin a développé pour la Nouvelle Calédonie (1984).
Pour sa part, Bernard Poirine explique, depuis une perspective socio-économique, que cette analyse lui fait minimiser le fait que la compétition scolaire n’est pas vécue de la même façon par tous les élèves polynésiens. Par ailleurs, il insiste davantage sur l’importance des catégories socioprofessionnelles des familles plus que sur leur « appartenance culturelle » ou ethnicité (Poirine, 1996). On est ici proche des analyses développées par Kohler et Wacquant pour la Nouvelle-Calédonie (1985).
Même si cette étiologie de l’échec scolaire est pour partie commune avec celle développée en Nouvelle Calédonie, de par leur histoire, ces deux territoires ne portent pas le même héritage. En effet, là où la Nouvelle-Calédonie a subi une colonie de peuplement et a connu une ségrégation scolaire forte avec des écoles spécifiques pour les indigènes (cf. chapitre de Salaün dans ce volume), les Polynésiens sont toujours restés majoritaires dans la population (80% aujourd’hui), et on a constaté dès les premières décennies de la colonisation l’émergence d’une classe dominante métisse, les Demis. Si elle n’est pas institutionnalisée comme dans la Nouvelle-Calédonie coloniale, la ségrégation scolaire est pourtant une réalité des EFO avec un premier clivage entre les ruraux et les urbains, et un deuxième clivage entre Tahiti et le reste des îles. Cette réalité inscrit le système scolaire dans « une relation duale : celui des élèves des archipels éloignés et celui des élèves des îles de la société » En effet, selon la zone géographique, il existe ou non des établissements du second degré, une répartition selon la densité scolaire a été privilégié. « Lorsque la logique d’implantation confinait à l’absurde, avec des écoles ne comptant qu’une classe de moins de 10 élèves ou des collèges de moins de 200 élèves, a été privilégiée, en substitution, l’organisation d’hébergements et de transports scolaires inter-îles par voies maritime et aérienne. » (CTC, 2014)
Ce déterminisme géographique représente 1,6 % du budget du système éducatif soit 1,053 milliards FCP afin que les élèves puissent bénéficier d’une prise en charge des transports qu’ils soient terrestres, maritimes ou aériens.
La totalité des dépenses du système éducatif polynésien s’élèvent à 65 milliards FCP en 2012 contre 52 milliards FCP en 2004. (CTC,2014)
Dans le cadre des lois d’autonomie qui se succèdent depuis la fin des années 1970, des adaptations, restreintes, ont concerné certaines disciplines scolaires, avec, par exemple, l’introduction dans l’horaire normale des écoles maternelles et primaires (donc à titre obligatoire…) d’un enseignement Langues et culture polynésienne (cf. l’article de Jacques Vernaudon dans ce volume).
D’autres adaptations ont été mises en œuvre comme la création de structures originales afin de répondre au plus près aux difficultés de certains élèves par la création de CETAD ou de CJA.
Ces adaptations, qui concernent l’ensemble des élèves, ne suffisent pas à pallier un déterminisme géographique, lui-même lié au déterminisme social.
La dispersion de l’habitat entre des archipels éloignés les uns des autres s’accompagne, dans un contexte de scolarité obligatoire, de considérables difficultés de transport. Elle engendre également un nomadisme scolaire qui devient une cause d’échec scolaire. Les élèves sont contraints de se déplacer dans la famille élargie ou en internat afin de se rapprocher au plus près des écoles. Les conditions de scolarité de ces élèves sont particulièrement difficiles. Plus la scolarité s’allonge plus le déplacement est long pour les élèves des îles.
Afin de retarder la séparation avec les parents, des groupements d’observations dispersés (GOD) existent, rappelant les classes uniques en métropole, où tous les niveaux sont présents dans une même classe. L’isolement géographique touche également les enseignants, qui, depuis le développement du système scolaire, ne se pressent pas en masse pour demander les affectations les plus éloignées de Tahiti. Cela a pu conduire à recruter des personnels qui ne satisfaisaient pas aux exigences en termes de titres universitaires, environ 30% des enseignants recrutés sans le baccalauréat (CTC, 2014) ; et aujourd’hui encore, certaines circonscriptions héberge un pourcentage très conséquent d’enseignants non titulaires : « cette situation a cependant conduit à maintenir devant les élèves les plus éloignés des exigences scolaires, les enseignants les moins instruits et les moins formés » (CTC 2014).
Le partage des compétences entre l’Etat et le Territoire
La gouvernance du système éducatif polynésien repose sur un mode partenarial entre l’Etat et le territoire régi par la convention du 4 avril 2007 lié à la la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Différentes conventions se sont succédées, avec pour but de notifier la répartition des compétences entre l’Etat et le territoire car les compétences ne sont pas toutes transférées.
Si un statut « d’autonomie » a été reconnu à la Polynésie française en 1984, le transfert de la compétence éducative avait été rendu possible dès 1957 (au primaire) dans un premier temps, puis au secondaire (1987) par la suite. L’Etat reste garant des diplômes nationaux.
En tant que principal financeur, L’Etat, représenté par le Vice-Recteur, met à disposition 92% des moyens humains et matériels afin de répondre au mieux à la Constitution qui prévoit « l’égal accès de l’enfant (et de l’adulte) à l’instruction » sur l’ensemble du territoire de la République. La majorité des enseignants exercent selon le principe d’une Mise à Disposition (MAD) pour la Polynésie française. Ces personnels sont sélectionnés sur dossiers à travers leurs parcours, leurs compétences et sont affectés par le ministre polynésien sur un établissement scolaire territorial. `
Une fois, les candidats sélectionnés, ils ne bénéficient que d’une seule journée de formation afin de contextualiser leurs enseignements. Parfois, cette dernière a lieu alors que certains ne sont pas encore arrivés en Polynésie. L’adaptation se veut rapide avec pour rappel que la loi est la même pour tous, étant donné que la République est une et indivisible. Cependant, exercer en Polynésie française nécessite quelques ajustements pour un fonctionnaire métropolitain, car il existe des différences juridiques entre ces deux systèmes.
En effet, toutes les lois votées en métropole ne sont pas répercutées automatiquement en Polynésie française.Pour ce faire, certaines doivent être adopté par l’assemblée territoriale. I
Les acteurs de la communauté éducative doivent être informés de ces différences d’applications ; e qui est plus facile depuis l’entrée en vigueur du code de l’éducation pour la Polynésie française (2015).
Auparavant, le flou juridique engendrait quelques incompréhensions, comme nous le raconte, Marc Debene, en préface de ce code : « « Ainsi a t’on pu dans certains établissements publics polynésiens rappeler l’interdiction du port des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse alors que la loi du 15 mars 2004 (Art. L. 141-5-1 du Code de l’éducation) n’a pas étendue à la Polynésie française (Art.L.163-1 ne le mentionne pas !). »
En outre, le territoire dispose d’un ministre de l’Education polynésien, et les services de l’éducation se trouvent au sein de la Direction Générale de l’Education et des enseignements (DGEE). Depuis juin 2004, cette nouvelle entité rassemble la Division de l’enseignement secondaire (crée en 1987) et la Division de l’enseignement primaire (crée en 2001) Cette fusion permet la prise en charge de l’entretien des bâtiments scolaires, des bourses, des allocations d’études, du transport avec l’aide des communes mais également des questions relatives au domaine du numérique, de la vie scolaire, de l’orientation et de l’insertion ou encore de l’action pédagogique et éducative.
Cependant concernant le second degré, l’Etat s’est engagé à travers la convention du 4 avril 2007 à participer aux constructions scolaires nécessaire afin de « désengorger » certains établissements qui subissent une surpopulation d’élèves. Un bon exemple est le collège de Taravao situé sur la Presqu’île de Tahiti, soit à 55 kms de Papeete. Il a été conçu pour accueillir entre 600 et 700 élèves et il en reçoit 1300. Après plusieurs faux départs, un nouveau collège est en construction à Mataiea, afin de pouvoir le désengorger ainsi que celui de Papara.
Le pilotage pédagogique est compliqué par l’éloignement de certains IA-IPR, qui résident en Nouvelle-Calédonie. Les inspections se limitent par conséquent à des missions entre 15 et 20 jours, deux à trois fois par an lorsque cela est possible.
La relation partenariale avec l’Etat repose sur une communication, qui a par le passé, parfois fait défaut. En outre, celle-ci a été plusieurs fois conflictuelle suite à un manque de transparence de la part de la collectivité de la Polynésie sur la tenue des comptes. Il n’existe aucun comité de suivi, et par conséquent, il est difficile de chiffrer le bilan des opérations. Comme le souligne la chambre territoriale des comptes « L’opacité des relations financières a mis à mal le fondement du partenariat » (CTC,2014).
Cette relation est également compliquée par ce qui est perçu, depuis la métropole, comme un « manque d’efficience ». Les résultats scolaires ne sont pas à la hauteur des moyens alloués par l’Etat.
« La dépense scolaire par élève était, en 2014, respectivement de 8.223 euros en Polynésie française et de 10.539 euros en Nouvelle-Calédonie, contre 7.700 euros en 2013 (dernier chiffre connu) pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer », constate la cour des comptes (2015) Même si les moyens mis en oeuvre « ont permis des progrès », avec notamment la progression du nombre de bacheliers, « les résultats restent en deçà des références métropolitaines ». Environ 35% des élèves de Polynésie et 20% de ceux de Nouvelle-Calédonie sortent encore du système sans diplôme ni qualification « contre environ 10% en métropole » (CTC, 2015).
Le coût et les performances métropolitaines restent l’étalon à l’aune duquel se mesure le rendement scolaire.Toutefois, l’Etat a cependant accepté certaines adaptations locales, encourageant la création de dispositifs propre à la Polynésie française. L’objectif est de réduire le nombres d’abandons et d’augmenter le niveau de qualifications de la population en vue de la croissance économique, avec la proposition d’un enseignement professionnel dans une structure spécifique à la Polynésie française : les Centres d’éducation aux technologies appropriées au Développement (CETAD) que nous allons maintenant présenter.

Les Centres d’éducation aux technologies appropriées au développement (CETAD)
Les Centres de jeunes adolescents (CJA)
Structures spécifiques ou gestion de la difficulté scolaire ?
Les CETAD sont des structures éducatives professionnelles implantées géographiquement sur le site d’un collège ou d’un lycée. Ils sont donc placés sous l’autorité du chef d’établissement avec un professeur détaché quelques heures pour en assurer la coordination. Tous les collèges ne sont pas pourvus de CETAD. Il en existe 12 réparties sur les cinq archipels, qui scolarisent environ un millier d’élèves. Cette structure ne remplace pas les Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, (SEGPA), qui sont présentes dans certains établissements scolaires du territoire.
Les CETAD ont été crée en 1981 pour former des ouvriers polyvalents semi-qualifiés par l’obtention d’un CAP-D (Certificat d’aptitude au développement), l’objectif étant également de « bien vivre dans les iles éloignés » (CTC, 2014). Ce sont les ateliers complémentaires des collèges qui ont été transformés en ateliers polyvalents. Ils ont été adaptés aux exigences économiques locales et aux conditions sociale et culturelle des adolescents polynésiens. Il s’agissait d’offrir à des élèves éloignés une formation qualifiante nécessaire afin de pouvoir rester dans leurs archipels si tel est leur désir.
En 1983, des filières spécifiques comme la construction et l’entretien des bâtiments (CEB), ainsi que l’activité familiale artisanale et touristiques (AFAT) ont été ouvertes. En 1988, ce sont les filières de gestion et entretien en milieu marin (GEMM) et gestion et entretien de la petite exploitation rurale (GPER) qui viennent compléter l’offre de formation dans les CETAD.
Les élèves y ont accès à la fin de la 5ème, niveau considéré comme un palier d’orientation jusqu’en 2016. A l’origine, le CETAD dispensait deux années de formation, portées aujourd’hui à trois ans après la 5e. A la fin du cursus, les élèves passent le diplôme national du brevet professionnel en vue d’intégrer un lycée professionnel ainsi que CAP-D, qu’ils peuvent utiliser lors de leur entrée dans la vie active.
Cette structure permet aux élèves en difficulté, d’appréhender une autre façon d’apprendre en alliant théorie et pratique, avec pour certains une projection professionnelle.
Malheureusement le recrutement de ces élèves se faisait à partir de leurs difficultés en mathématiques et en français ; ce qui entrainait par la suite un faible taux de réussite aux diplômes du fait de la faiblesse des compétences acquises dans les matières disciplinaires « En effet, sur les élèves de 6èmedécelés avec des difficultés en français et en maths soit environ 50% des élèves, beaucoup, sinon tous intègrent la voie professionnelle ».(p. 93, CTC, 2014).
Par ailleurs, le CETAD a été utilisé pour des élèves en mal de repères, pour lesquels l’enseignement pratique permettait de redonner du sens à une théorie devenue trop abstraite. Ainsi, il a pu remédier à certaines situations d’absentéisme. Ces élèves ne sont pas pour autant sortis de l’enceinte de l’établissement scolaire puisqu’ils bénéficient que les collégiens ou lycéens : même règlement intérieur, sauf en lycée où l’âge entre en ligne de compte, même temps de vie scolaire et d’études partagés, ateliers sur le site du collège ou du lycée. La différence avec le collège se trouve dans la notation, puisqu’elle passe par des codes couleurs se rapprochant davantage de l’évaluation en primaire : vert pour les compétences acquises, rouge pour celles non acquises.
Cette structure a été créée afin de répondre à la scolarisation des élèves des îles et a connu comme dérive de traiter principalement la difficulté scolaire. L’Etat a soutenu ce projet jusqu’à cette année (2016) où par la réforme du collège, le recrutement au CETAD en fin de 5èmeprends fin. Il aura désormais lieu après la 3ème.
Parallèlement à cette structure, le territoire a soutenu la création des Centres de jeunes adolescents (CJA) en 1978. Ils ont d’abord été créés à titre expérimental pour ensuite se multiplier dans les années 80, soit en même temps que les CETAD. Une rivalité est apparue entre ces deux structures. Les CJA ont été accusés de n’apporter aucune valorisation et formation professionnelle contrairement à l’enseignement proposé dans les CETAD, le but recherché n’étant pas le même. Ces structures ont été créées pour répondre à la demande d’occupation des jeunes de 14 ans, non soumis à l’obligation scolaire et ayant échoué au certificat d’études. Leur objectif était de réinsérer ces jeunes souvent en échec par la formation à une économie de subsistance. A travers des formations très genrées, les filles pratiquaient la couture, et la cuisine tandis que les garçons faisaient de l’agriculture et de la mécanique.
Malgré leurs divergences, ces deux structures se complètent et sont devenus des partenaires de la réussite éducative où le jeune redevient acteur de sa scolarité. En parallèle, la plateforme proposée par l’Education Nationale en métropole telle que la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) a connu quelques adaptations mais a le mérite d’exister sur le territoire, au sein de la DGEE. Elle vise à réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans diplôme dès le primaire, et à prendre en charge les élèves décrocheurs (âgés de plus de 16 ans) en vue d’un raccrochage et/ou d’une qualification reconnue, pour une insertion sociale et professionnelle durable.
Cependant la réforme du collège a commencé à transformer le paysage de ces deux structures locales. Du fait d’une réticence des autorités locales à faire disparaître les CETAD par crainte d’une hausse des élèves absentéistes, ils évoluent à la rentrée 2016. La collectivité de la Polynésie rappelle que « la suppression des CETAD aurait des effets catastrophiques immédiats en terme de décrochage scolaire » (CTC 2014).
Le pallier d’orientation en fin de 5èmedisparaît pour laisser place à un recrutement en fin de 3èmece qui rapproche davantage les CETAD des antennes de lycées professionnels existant en Nouvelle-Calédonie. La rénovation de cette structure spécifique à la Polynésie tient également en compte l’évolution du niveau de qualification des élèves. Auparavant le CAP-D n’était pas reconnu par l’Etat au niveau V ce qui contribuait à dire que les élèves de CETAD étaient des décrocheurs au sens même de la loi de 2009, qui concerne « les anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire ».
Aujourd’hui, une question est de savoir quel CAP ces structures vont proposer. Est-il possible de conserver le caractère polyvalent de l’éventail des formations ? L’Etat va-t-il reconnaître ce diplôme ? Quelle différence existe-t-il avec les lycées professionnels ? Des passerelles sont-elles envisageables ou une hiérarchisation des structures va-t-elle s’imposer ? Les structures sont-elles en capacité matérielle de faire face à ce changement et de répondre ainsi aux exigences nationales ? Le diplôme proposé aura t’il une meilleure reconnaissance du CAP-D sur le marché du travail polynésien ?
Le territoire a suivi également la réforme du collège pour inclure davantage les CJA dans le système éducatif polynésien. Ils proposeront désormais différents parcours sous forme de modules adaptés à la difficulté de l’élève dans le but d’une réinsertion dans le système traditionnel classique, se rapprochant ainsi des classes relais en métropole. La réforme du collège va-t-elle pouvoir proposer des temps en ateliers professionnels afin de répondre à la demande de certains élèves d’être davantage en pratique ? Va-t-elle réussir à corriger les carences du primaire comme le soulignait le rapport de la Chambre territoriale des comptes ?
Conclusion
La difficulté scolaire en Polynésie est une réalité, liée à un déterminisme géographique et social mais aussi à son histoire scolaire récente. Historiquement, elle a été contrainte d’adopter le système éducatif métropolitain, au travers des partages de compétences elle a fait le choix de poursuivre sur cette voie avec le maintien des programmes nationaux destiné à atteindre l’objectif la réussite aux diplômes nationaux.
Malgré la crise de l’école en Polynésie française, l’éducation prioritaire n’a pas été un impératif pour le territoire pendant plus de vingt ans. Quelques adaptations locales ont été possibles et l’Etat a soutenu la création de structures originales que sont les CETAD et le CJA. Toutefois faute de résultats convaincants,(le nombre d’élèves ne fait que chuter) l’originalité de ces structures s’estompe avec la mise en œuvre de la réforme du collège applicable en Polynésie française à la rentrée d’août 2016.
Le système éducatif polynésien s’adapte et rénove ces structures afin de favoriser une réussite des élèves polynésiens reconnue au niveau national et répondant par ailleurs, aux exigences européennes. La question est de savoir si ces rénovations vont être l’occasion d’adapter la réforme des collèges au contexte polynésien ?
La valorisation des ateliers au CETAD permettra t’elle d’appliquer les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) ?
Aujourd’hui, le gouvernement semble à l’écoute de la jeunesse, avec par exemple, l’organisation des États généraux ou encore des Assises de la jeunesse (2016). Ces initiatives sont appréciées par les jeunes qui souhaitent participer à l’élaboration de la nouvelle Charte de l’éducation. Ils ont notamment demandé une meilleure valorisation de la culture locale.
Comme dans l’ensemble de l’outre-mer français, l’École est le « produit de la rencontre coloniale » (Salaün, 2013) L’important est donc de trouver un consensus politique grâce auquel elle n’est pas pris en otage, permettant ainsi d’avancer vers un destin commun, celui de la réussite de tous les élèves.
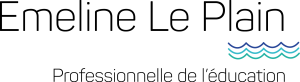
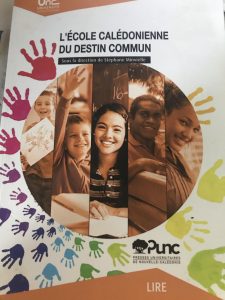
Participation et communication au colloque L’école calédonienne du destin commun à Nouméa en octobre 2016. Cette communication a fait l’objet d’une publication dans les Actes de ce colloque. Vous trouverez les références en bas de pages.

Entre reproduction du modèle national et « autonomie » du pays : Quelques aspects de la gestion de la difficulté scolaire en Polynésie française.
A 18 000 kilomètres de Paris, la Polynésie française est constituée de 118 îles dispersées sur 5 millions de km2maritimes. Elle s’étire sur une surface aussi vaste que l’Europe. En 2012, le dernier recensement comptabilise 268 207 habitants répartis sur l’ensemble des cinq archipels. Cependant 75% des habitants se concentrent sur les îles du vent, dans l’archipel de la société, entre Tahiti et Moorea.
Si l’histoire coloniale qui la lie à la République française ne ressemble pas à celle de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française partage aujourd’hui avec cette collectivité un héritage qui mêle une grande diversité ethnique de sa population et de très fortes inégalités socio-économiques principalement entre quatre communautés : les Polynésiens qui représentaient en 1988, 82 % de la population, les Asiatiques (6%), les Européens ( 11% dont 98% de nationalité française) et les « demis » (issus de mariages mixtes) qui sont également représentés dans les trois premiers groupes ethniques (ITSTAT, 1988).
Ces inégalités ont été mesurées dans un document de travail de l’Agence française de développement (Herrera & Merceron, 2010) intitulé « Les approches de la pauvreté en Polynésie française ». En utilisant l’indice de Gini, ce document constate que la Polynésie française se rapproche davantage des pays latino-américains que de la métropole. En effet, « Les 20% (le quintile) des ménages polynésiens les plus riches capte près de la moitié (47%) du revenu total des ménages, tandis que le quintile des ménages les plus pauvres en reçoit à peine 6%, et que « la pauvreté est nettement plus élevé chez les ménages qui se ressentent « Maohi » (Polynésiens) que chez les « Popa’a » (Européens), cela provient pour l’essentiel de différentiels de niveaux de diplômes et d’insertion sur le marché du travail ».
Comme en Nouvelle-Calédonie, les fonctionnaires mis à disposition par l’Etat font partie des plus favorisés. Ils , bénéficient de traitements indexés qui s’élèvent, en moyenne, à trois fois le salaire minimum polynésien (149 491 fcp soit 1252 euros). Il n’est pas anodin de noter que le niveau de vie dont bénéficie le corps enseignant l’éloigne de factodes conditions dans lesquelles vivent de nombreuses familles polynésiennes.
Il existe également des différences entre les enseignants du premier et du second degré. Les premiers sont quasiment tous recrutés localement, tandis que les seconds sont à 50% des enseignants mis à disposition de la Polynésie française. L’autre moitié bénéficie de la reconnaissance de leur centre d’intérêt moral et matériel (CIMM) sur le territoire, ce qui les protège de la limitation de durée de séjour, qui est égal à deux ans renouvelable une fois en lien avec le décret de 1996.
L’institution scolaire y est pour ainsi dire calquée sur le modèle métropolitain : même organisation des examens mise à disposition d’enseignants du secondaire, diplôme nationaux, etc. Comme en Nouvelle-Calédonie, le système scolaire polynésien a été historiquement construit sur le modèle métropolitain avec une accélération de la mise en conformité de ce système après la Seconde Guerre mondiale (cf. chapitre de Marie Salaün dans ce volume). Par ailleurs, il se caractérise par l’aspect massif des inégalités scolaires, réalité que la plupart des diagnostics institutionnels expliquent par un « retard » de la Polynésie française par rapport à la métropole. Ainsi, le dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes estime-t-il que ses performances scolaires la situent au niveau de celles de la métropole il y a 20 ans (CTC, 2014). Le taux d’accès au baccalauréat général d’une classe d’âge (16, 5 %) est équivalent au niveau métropolitain de 1970.
D’après le recensement de 2012 : « plus de la moitié des enfants de moins de 18 ans vivent dans les familles dont le chef de ménage est employé ou ouvrier, un sur six vit dans une famille de retraité, ou sans activité professionnelle contre moins d’un sur dix en métropole et enfin un enfant sur quatre vit avec un parent cadre ou de profession intermédiaire, contre près d’un sur deux en métropole. »
[1]A l’entrée au collège, 53% des élèves sont issus de CSP défavorisées, une proportion qui atteint 90% dans certains établissements. En 2007, l’archipel a été qualifié par l’Inspection Générale de « vaste zone d’éducation prioritaire » (IGEN, 2007).
Les indicateurs convergent pour attester de l’ampleur de l’échec scolaire. Par exemple, les taux d’illettrisme recensés lors des Journées défense et citoyenneté (JDC anciennement JAPD) sont éloquents : alors qu’en métropole, les difficultés à l’écrit concernent 7 à 8 % de la population, ils se situent entre 40 et 41% en Polynésie française. De même, le nombre de sorties du système scolaire sans diplôme, ni qualification touche environ 2000 élèves, ce qui représente environ 30% des sortants, taux observé en métropole dans les années 80.
Ce taux est très éloigné de l’objectif fixé par la stratégie Lisbonne définie par le Conseil européen (2000) à savoir moins de 10%. Elle se donnait pour mission de réduire le nombre d’abandons et d’augmenter le niveau de qualification de la population en vue de la croissance économique européenne.
Comment peut on expliquer un si grand écart entre deux systèmes éducatifs pourtant structurellement si proches l’un de l’autre ?
Mon analyse propose de mettre au jour les tensions entre la nécessité de se conformer au modèle national et celle de s’adapter à des réalités locales très éloignées de celles pour lesquelles ce modèle a été et continue d’être pensé. Après un bref retour sur l’histoire du système éducatif local et un survol rapide de la littérature académique produite sur la Polynésie française, nous verrons concrètement comment dans le cadre d’un partage de compétences entre l’Etat et le Territoire, une partie de la difficulté scolaire est gérée.
Le système éducatif polynésien
Autant qu’il est possible de le savoir, avant l’arrivée des Européens qui débute à la fin du XVIIIème siècle, des lieux dédiés à la transmission étaient présents dans les villages de chaque district. On y enseignait l’art de la pêche, la rhétorique, la construction des pirogues, ou encore les conduites à tenir sur les marae, espaces sacrés. Ces écoles traditionnelles furent bousculées par l’arrivée des missionnaire protestants anglais de la London Missionary Society(1797) qui évangélisaient dans les langues locales (Peltzer, 1999).
En 1831, on dénombre une trentaine d’écoles missionnaires réparties sur le territoire, principalement sur l’île de Tahiti, les Îles sous-le-vent mais aussi les Australes et les Tuamotus. Par la suite, la France, souhaitant contrer l’influence britannique dans le Pacifique, imposa progressivement un protectorat (1842). Ce statut évolue en annexion (1880), et la Polynésie devient une colonie sous le nom des Etablissement français d’Océanie (EFO).
Une partie de la population, les ressortissants du royaume Pomare, se voit attribuer le bénéfice de la citoyenneté française par l’acte d’annexion. L’autre partie, à peut près équivalente en nombre, est considérée comme « sujets indigènes » de l’empire. Dans les faits, et en l’absence de possibilité d’exercer une véritable souveraineté populaire à partir de 1903, la distinction entre « sujets » et « citoyens » est peu opératoire. Il en va ainsi du domaine scolaire, car si le principe d’obligation est adopté localement en 1897, quinze ans après la métropole, il concerne de fait aussi bien les enfants des « citoyens » que ceux des « indigènes » et n’est que très partiellement respecté, puisqu’on peut estimer qu’à la veille du second conflit mondial, environ le quart de la population ne bénéficie pas de la scolarisation. Le clivage central est en fait celui qui oppose les écoles de la ville de Papeete, où sont scolarisés les enfants des fonctionnaires métropolitains et ceux des familles « demis » les plus fortunées, et qui, dotées d’enseignants français de métropole, appliquent les programmes en vigueur dans l’Hexagone, et le reste de la Polynésie, des districts ruraux de Tahiti aux tréfonds des vallées marquisiennes.
Devenus comme la Nouvelle-Calédonie, Territoire d’Outre mer (TOM) en 1946, les établissements français d’Océanie changent de nom en 1957 pour devenir la Polynésie française. La loi-cadre Deferre de 1956 accorde aux TOM une évolution vers l’autonomie par la création d’un conseil de gouvernement. Par le transfert de l’Etat au Territoire de la compétence de l’enseignement primaire et secondaire ainsi qu’en matière d’enseignements professionnel et technique, les établissements d’enseignements publics deviennent territoriaux.
Cependant l’Etat, à la demande de la représentation élue locale, conserve la compétence pour les programmes d’étude, les examens, les diplôme et la capacité requise pour enseigner. L’enseignement secondaire n’est créé qu’au début des années 1960, à la faveur des besoins des familles française venues travailler pour le Centre d’expérimentations nucléaires. C’est seulement en 1965 que le premier baccalauréat est organisé en Polynésie française.
Par ailleurs, l’Etat soutient la création de structures originale qui n’existe pas en métropole tel que les Centres d’Education aux Technologies adaptées au Développement (CETAD) en 1981.
En 1984, la Polynésie française dispose d’un statut d’autonomie interne puis obtient un statut d’autonomie en 2004, qui qualifie par la loi organique la Polynésie française de « Pays d’Outre-Mer au sein de la République »
Cette collectivité bénéficie donc d’une autonomie de plus en plus en large au niveau scolaire comme nous le montre le tableau, accessible dans les actes du colloque, présentant la répartition interne des compétences de la Polynésie française entre les organes du pays (Lechat & Argentin, 2011).
Après une première publication pionnière en 1975, sous l’égide de la Fédération des œuvres laïques (Barral, 1975), il faut attendre les années 1990 pour que le thème d’un « échec scolaire » des élèves polynésiens suscite l’intérêt.
On trouve tendanciellement deux orientations dans l’étiologie de l’échec scolaire tout comme en Nouvelle Calédonie (Salaün, 2005)
A une analyse que l’on pourrait qualifier de « culturaliste » s’oppose une explication qui met en avant la dimension socioéconomique. On peut éventuellement envisager une troisième orientation puisqu’on observe en surplomb un discours de l’institution scolaire elle-même, qui mêle les deux types d’analyses précités et aboutit au fait que les difficultés scolaires sont régulièrement imputées à des déterminants externes (notamment familiaux) et rarement venant de l’Ecole elle même.
Avec une orientation psychologique, Bertrand Troadec explique que si l’enfant polynésien ne réussit pas, c’est parce qu’il a développé « une cognition polynésienne » différente de celle de l’enfant métropolitain : « l’infériorité chronique de l’enfant tahitien par rapport à la norme occidentale tend à permettre d’affirmer que des conceptions spécifiques de la culture polynésienne résistent au phénomène d’acculturation » (Troadec, 1996, p. 60).
On retrouve ici le type d’analyse que Marie-Joëlle Dardelin a développé pour la Nouvelle Calédonie (1984).
Pour sa part, Bernard Poirine explique, depuis une perspective socio-économique, que cette analyse lui fait minimiser le fait que la compétition scolaire n’est pas vécue de la même façon par tous les élèves polynésiens. Par ailleurs, il insiste davantage sur l’importance des catégories socioprofessionnelles des familles plus que sur leur « appartenance culturelle » ou ethnicité (Poirine, 1996). On est ici proche des analyses développées par Kohler et Wacquant pour la Nouvelle-Calédonie (1985).
Même si cette étiologie de l’échec scolaire est pour partie commune avec celle développée en Nouvelle Calédonie, de par leur histoire, ces deux territoires ne portent pas le même héritage. En effet, là où la Nouvelle-Calédonie a subi une colonie de peuplement et a connu une ségrégation scolaire forte avec des écoles spécifiques pour les indigènes (cf. chapitre de Salaün dans ce volume), les Polynésiens sont toujours restés majoritaires dans la population (80% aujourd’hui), et on a constaté dès les premières décennies de la colonisation l’émergence d’une classe dominante métisse, les Demis. Si elle n’est pas institutionnalisée comme dans la Nouvelle-Calédonie coloniale, la ségrégation scolaire est pourtant une réalité des EFO avec un premier clivage entre les ruraux et les urbains, et un deuxième clivage entre Tahiti et le reste des îles. Cette réalité inscrit le système scolaire dans « une relation duale : celui des élèves des archipels éloignés et celui des élèves des îles de la société » En effet, selon la zone géographique, il existe ou non des établissements du second degré, une répartition selon la densité scolaire a été privilégié. « Lorsque la logique d’implantation confinait à l’absurde, avec des écoles ne comptant qu’une classe de moins de 10 élèves ou des collèges de moins de 200 élèves, a été privilégiée, en substitution, l’organisation d’hébergements et de transports scolaires inter-îles par voies maritime et aérienne. » (CTC, 2014)
Ce déterminisme géographique représente 1,6 % du budget du système éducatif soit 1,053 milliards FCP afin que les élèves puissent bénéficier d’une prise en charge des transports qu’ils soient terrestres, maritimes ou aériens.
La totalité des dépenses du système éducatif polynésien s’élèvent à 65 milliards FCP en 2012 contre 52 milliards FCP en 2004. (CTC,2014)
Dans le cadre des lois d’autonomie qui se succèdent depuis la fin des années 1970, des adaptations, restreintes, ont concerné certaines disciplines scolaires, avec, par exemple, l’introduction dans l’horaire normale des écoles maternelles et primaires (donc à titre obligatoire…) d’un enseignement Langues et culture polynésienne (cf. l’article de Jacques Vernaudon dans ce volume).
D’autres adaptations ont été mises en œuvre comme la création de structures originales afin de répondre au plus près aux difficultés de certains élèves par la création de CETAD ou de CJA.
Ces adaptations, qui concernent l’ensemble des élèves, ne suffisent pas à pallier un déterminisme géographique, lui-même lié au déterminisme social.
La dispersion de l’habitat entre des archipels éloignés les uns des autres s’accompagne, dans un contexte de scolarité obligatoire, de considérables difficultés de transport. Elle engendre également un nomadisme scolaire qui devient une cause d’échec scolaire. Les élèves sont contraints de se déplacer dans la famille élargie ou en internat afin de se rapprocher au plus près des écoles. Les conditions de scolarité de ces élèves sont particulièrement difficiles. Plus la scolarité s’allonge plus le déplacement est long pour les élèves des îles.
Afin de retarder la séparation avec les parents, des groupements d’observations dispersés (GOD) existent, rappelant les classes uniques en métropole, où tous les niveaux sont présents dans une même classe. L’isolement géographique touche également les enseignants, qui, depuis le développement du système scolaire, ne se pressent pas en masse pour demander les affectations les plus éloignées de Tahiti. Cela a pu conduire à recruter des personnels qui ne satisfaisaient pas aux exigences en termes de titres universitaires, environ 30% des enseignants recrutés sans le baccalauréat (CTC, 2014) ; et aujourd’hui encore, certaines circonscriptions héberge un pourcentage très conséquent d’enseignants non titulaires : « cette situation a cependant conduit à maintenir devant les élèves les plus éloignés des exigences scolaires, les enseignants les moins instruits et les moins formés » (CTC 2014).
Le partage des compétences entre l’Etat et le Territoire
La gouvernance du système éducatif polynésien repose sur un mode partenarial entre l’Etat et le territoire régi par la convention du 4 avril 2007 lié à la la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Différentes conventions se sont succédées, avec pour but de notifier la répartition des compétences entre l’Etat et le territoire car les compétences ne sont pas toutes transférées.
Si un statut « d’autonomie » a été reconnu à la Polynésie française en 1984, le transfert de la compétence éducative avait été rendu possible dès 1957 (au primaire) dans un premier temps, puis au secondaire (1987) par la suite. L’Etat reste garant des diplômes nationaux.
En tant que principal financeur, L’Etat, représenté par le Vice-Recteur, met à disposition 92% des moyens humains et matériels afin de répondre au mieux à la Constitution qui prévoit « l’égal accès de l’enfant (et de l’adulte) à l’instruction » sur l’ensemble du territoire de la République. La majorité des enseignants exercent selon le principe d’une Mise à Disposition (MAD) pour la Polynésie française. Ces personnels sont sélectionnés sur dossiers à travers leurs parcours, leurs compétences et sont affectés par le ministre polynésien sur un établissement scolaire territorial. `
Une fois, les candidats sélectionnés, ils ne bénéficient que d’une seule journée de formation afin de contextualiser leurs enseignements. Parfois, cette dernière a lieu alors que certains ne sont pas encore arrivés en Polynésie. L’adaptation se veut rapide avec pour rappel que la loi est la même pour tous, étant donné que la République est une et indivisible. Cependant, exercer en Polynésie française nécessite quelques ajustements pour un fonctionnaire métropolitain, car il existe des différences juridiques entre ces deux systèmes.
En effet, toutes les lois votées en métropole ne sont pas répercutées automatiquement en Polynésie française.Pour ce faire, certaines doivent être adopté par l’assemblée territoriale. I
Les acteurs de la communauté éducative doivent être informés de ces différences d’applications ; e qui est plus facile depuis l’entrée en vigueur du code de l’éducation pour la Polynésie française (2015).
Auparavant, le flou juridique engendrait quelques incompréhensions, comme nous le raconte, Marc Debene, en préface de ce code : « « Ainsi a t’on pu dans certains établissements publics polynésiens rappeler l’interdiction du port des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse alors que la loi du 15 mars 2004 (Art. L. 141-5-1 du Code de l’éducation) n’a pas étendue à la Polynésie française (Art.L.163-1 ne le mentionne pas !). »
En outre, le territoire dispose d’un ministre de l’Education polynésien, et les services de l’éducation se trouvent au sein de la Direction Générale de l’Education et des enseignements (DGEE). Depuis juin 2004, cette nouvelle entité rassemble la Division de l’enseignement secondaire (crée en 1987) et la Division de l’enseignement primaire (crée en 2001) Cette fusion permet la prise en charge de l’entretien des bâtiments scolaires, des bourses, des allocations d’études, du transport avec l’aide des communes mais également des questions relatives au domaine du numérique, de la vie scolaire, de l’orientation et de l’insertion ou encore de l’action pédagogique et éducative.
Cependant concernant le second degré, l’Etat s’est engagé à travers la convention du 4 avril 2007 à participer aux constructions scolaires nécessaire afin de « désengorger » certains établissements qui subissent une surpopulation d’élèves. Un bon exemple est le collège de Taravao situé sur la Presqu’île de Tahiti, soit à 55 kms de Papeete. Il a été conçu pour accueillir entre 600 et 700 élèves et il en reçoit 1300. Après plusieurs faux départs, un nouveau collège est en construction à Mataiea, afin de pouvoir le désengorger ainsi que celui de Papara.
Le pilotage pédagogique est compliqué par l’éloignement de certains IA-IPR, qui résident en Nouvelle-Calédonie. Les inspections se limitent par conséquent à des missions entre 15 et 20 jours, deux à trois fois par an lorsque cela est possible.
La relation partenariale avec l’Etat repose sur une communication, qui a par le passé, parfois fait défaut. En outre, celle-ci a été plusieurs fois conflictuelle suite à un manque de transparence de la part de la collectivité de la Polynésie sur la tenue des comptes. Il n’existe aucun comité de suivi, et par conséquent, il est difficile de chiffrer le bilan des opérations. Comme le souligne la chambre territoriale des comptes « L’opacité des relations financières a mis à mal le fondement du partenariat » (CTC,2014).
Cette relation est également compliquée par ce qui est perçu, depuis la métropole, comme un « manque d’efficience ». Les résultats scolaires ne sont pas à la hauteur des moyens alloués par l’Etat.
« La dépense scolaire par élève était, en 2014, respectivement de 8.223 euros en Polynésie française et de 10.539 euros en Nouvelle-Calédonie, contre 7.700 euros en 2013 (dernier chiffre connu) pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer », constate la cour des comptes (2015) Même si les moyens mis en oeuvre « ont permis des progrès », avec notamment la progression du nombre de bacheliers, « les résultats restent en deçà des références métropolitaines ». Environ 35% des élèves de Polynésie et 20% de ceux de Nouvelle-Calédonie sortent encore du système sans diplôme ni qualification « contre environ 10% en métropole » (CTC, 2015).
Le coût et les performances métropolitaines restent l’étalon à l’aune duquel se mesure le rendement scolaire.Toutefois, l’Etat a cependant accepté certaines adaptations locales, encourageant la création de dispositifs propre à la Polynésie française. L’objectif est de réduire le nombres d’abandons et d’augmenter le niveau de qualifications de la population en vue de la croissance économique, avec la proposition d’un enseignement professionnel dans une structure spécifique à la Polynésie française : les Centres d’éducation aux technologies appropriées au Développement (CETAD) que nous allons maintenant présenter.

Les Centres d’éducation aux technologies appropriées au développement (CETAD)
Les Centres de jeunes adolescents (CJA)
Structures spécifiques ou gestion de la difficulté scolaire ?
Les CETAD sont des structures éducatives professionnelles implantées géographiquement sur le site d’un collège ou d’un lycée. Ils sont donc placés sous l’autorité du chef d’établissement avec un professeur détaché quelques heures pour en assurer la coordination. Tous les collèges ne sont pas pourvus de CETAD. Il en existe 12 réparties sur les cinq archipels, qui scolarisent environ un millier d’élèves. Cette structure ne remplace pas les Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, (SEGPA), qui sont présentes dans certains établissements scolaires du territoire.
Les CETAD ont été crée en 1981 pour former des ouvriers polyvalents semi-qualifiés par l’obtention d’un CAP-D (Certificat d’aptitude au développement), l’objectif étant également de « bien vivre dans les iles éloignés » (CTC, 2014). Ce sont les ateliers complémentaires des collèges qui ont été transformés en ateliers polyvalents. Ils ont été adaptés aux exigences économiques locales et aux conditions sociale et culturelle des adolescents polynésiens. Il s’agissait d’offrir à des élèves éloignés une formation qualifiante nécessaire afin de pouvoir rester dans leurs archipels si tel est leur désir.
En 1983, des filières spécifiques comme la construction et l’entretien des bâtiments (CEB), ainsi que l’activité familiale artisanale et touristiques (AFAT) ont été ouvertes. En 1988, ce sont les filières de gestion et entretien en milieu marin (GEMM) et gestion et entretien de la petite exploitation rurale (GPER) qui viennent compléter l’offre de formation dans les CETAD.
Les élèves y ont accès à la fin de la 5ème, niveau considéré comme un palier d’orientation jusqu’en 2016. A l’origine, le CETAD dispensait deux années de formation, portées aujourd’hui à trois ans après la 5e. A la fin du cursus, les élèves passent le diplôme national du brevet professionnel en vue d’intégrer un lycée professionnel ainsi que CAP-D, qu’ils peuvent utiliser lors de leur entrée dans la vie active.
Cette structure permet aux élèves en difficulté, d’appréhender une autre façon d’apprendre en alliant théorie et pratique, avec pour certains une projection professionnelle.
Malheureusement le recrutement de ces élèves se faisait à partir de leurs difficultés en mathématiques et en français ; ce qui entrainait par la suite un faible taux de réussite aux diplômes du fait de la faiblesse des compétences acquises dans les matières disciplinaires « En effet, sur les élèves de 6èmedécelés avec des difficultés en français et en maths soit environ 50% des élèves, beaucoup, sinon tous intègrent la voie professionnelle ».(p. 93, CTC, 2014).
Par ailleurs, le CETAD a été utilisé pour des élèves en mal de repères, pour lesquels l’enseignement pratique permettait de redonner du sens à une théorie devenue trop abstraite. Ainsi, il a pu remédier à certaines situations d’absentéisme. Ces élèves ne sont pas pour autant sortis de l’enceinte de l’établissement scolaire puisqu’ils bénéficient que les collégiens ou lycéens : même règlement intérieur, sauf en lycée où l’âge entre en ligne de compte, même temps de vie scolaire et d’études partagés, ateliers sur le site du collège ou du lycée. La différence avec le collège se trouve dans la notation, puisqu’elle passe par des codes couleurs se rapprochant davantage de l’évaluation en primaire : vert pour les compétences acquises, rouge pour celles non acquises.
Cette structure a été créée afin de répondre à la scolarisation des élèves des îles et a connu comme dérive de traiter principalement la difficulté scolaire. L’Etat a soutenu ce projet jusqu’à cette année (2016) où par la réforme du collège, le recrutement au CETAD en fin de 5èmeprends fin. Il aura désormais lieu après la 3ème.
Parallèlement à cette structure, le territoire a soutenu la création des Centres de jeunes adolescents (CJA) en 1978. Ils ont d’abord été créés à titre expérimental pour ensuite se multiplier dans les années 80, soit en même temps que les CETAD. Une rivalité est apparue entre ces deux structures. Les CJA ont été accusés de n’apporter aucune valorisation et formation professionnelle contrairement à l’enseignement proposé dans les CETAD, le but recherché n’étant pas le même. Ces structures ont été créées pour répondre à la demande d’occupation des jeunes de 14 ans, non soumis à l’obligation scolaire et ayant échoué au certificat d’études. Leur objectif était de réinsérer ces jeunes souvent en échec par la formation à une économie de subsistance. A travers des formations très genrées, les filles pratiquaient la couture, et la cuisine tandis que les garçons faisaient de l’agriculture et de la mécanique.
Malgré leurs divergences, ces deux structures se complètent et sont devenus des partenaires de la réussite éducative où le jeune redevient acteur de sa scolarité. En parallèle, la plateforme proposée par l’Education Nationale en métropole telle que la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) a connu quelques adaptations mais a le mérite d’exister sur le territoire, au sein de la DGEE. Elle vise à réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans diplôme dès le primaire, et à prendre en charge les élèves décrocheurs (âgés de plus de 16 ans) en vue d’un raccrochage et/ou d’une qualification reconnue, pour une insertion sociale et professionnelle durable.
Cependant la réforme du collège a commencé à transformer le paysage de ces deux structures locales. Du fait d’une réticence des autorités locales à faire disparaître les CETAD par crainte d’une hausse des élèves absentéistes, ils évoluent à la rentrée 2016. La collectivité de la Polynésie rappelle que « la suppression des CETAD aurait des effets catastrophiques immédiats en terme de décrochage scolaire » (CTC 2014).
Le pallier d’orientation en fin de 5èmedisparaît pour laisser place à un recrutement en fin de 3èmece qui rapproche davantage les CETAD des antennes de lycées professionnels existant en Nouvelle-Calédonie. La rénovation de cette structure spécifique à la Polynésie tient également en compte l’évolution du niveau de qualification des élèves. Auparavant le CAP-D n’était pas reconnu par l’Etat au niveau V ce qui contribuait à dire que les élèves de CETAD étaient des décrocheurs au sens même de la loi de 2009, qui concerne « les anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire ».
Aujourd’hui, une question est de savoir quel CAP ces structures vont proposer. Est-il possible de conserver le caractère polyvalent de l’éventail des formations ? L’Etat va-t-il reconnaître ce diplôme ? Quelle différence existe-t-il avec les lycées professionnels ? Des passerelles sont-elles envisageables ou une hiérarchisation des structures va-t-elle s’imposer ? Les structures sont-elles en capacité matérielle de faire face à ce changement et de répondre ainsi aux exigences nationales ? Le diplôme proposé aura t’il une meilleure reconnaissance du CAP-D sur le marché du travail polynésien ?
Le territoire a suivi également la réforme du collège pour inclure davantage les CJA dans le système éducatif polynésien. Ils proposeront désormais différents parcours sous forme de modules adaptés à la difficulté de l’élève dans le but d’une réinsertion dans le système traditionnel classique, se rapprochant ainsi des classes relais en métropole. La réforme du collège va-t-elle pouvoir proposer des temps en ateliers professionnels afin de répondre à la demande de certains élèves d’être davantage en pratique ? Va-t-elle réussir à corriger les carences du primaire comme le soulignait le rapport de la Chambre territoriale des comptes ?
Conclusion
La difficulté scolaire en Polynésie est une réalité, liée à un déterminisme géographique et social mais aussi à son histoire scolaire récente. Historiquement, elle a été contrainte d’adopter le système éducatif métropolitain, au travers des partages de compétences elle a fait le choix de poursuivre sur cette voie avec le maintien des programmes nationaux destiné à atteindre l’objectif la réussite aux diplômes nationaux.
Malgré la crise de l’école en Polynésie française, l’éducation prioritaire n’a pas été un impératif pour le territoire pendant plus de vingt ans. Quelques adaptations locales ont été possibles et l’Etat a soutenu la création de structures originales que sont les CETAD et le CJA. Toutefois faute de résultats convaincants,(le nombre d’élèves ne fait que chuter) l’originalité de ces structures s’estompe avec la mise en œuvre de la réforme du collège applicable en Polynésie française à la rentrée d’août 2016.
Le système éducatif polynésien s’adapte et rénove ces structures afin de favoriser une réussite des élèves polynésiens reconnue au niveau national et répondant par ailleurs, aux exigences européennes. La question est de savoir si ces rénovations vont être l’occasion d’adapter la réforme des collèges au contexte polynésien ?
La valorisation des ateliers au CETAD permettra t’elle d’appliquer les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) ?
Aujourd’hui, le gouvernement semble à l’écoute de la jeunesse, avec par exemple, l’organisation des États généraux ou encore des Assises de la jeunesse (2016). Ces initiatives sont appréciées par les jeunes qui souhaitent participer à l’élaboration de la nouvelle Charte de l’éducation. Ils ont notamment demandé une meilleure valorisation de la culture locale.
Comme dans l’ensemble de l’outre-mer français, l’École est le « produit de la rencontre coloniale » (Salaün, 2013) L’important est donc de trouver un consensus politique grâce auquel elle n’est pas pris en otage, permettant ainsi d’avancer vers un destin commun, celui de la réussite de tous les élèves.
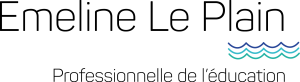
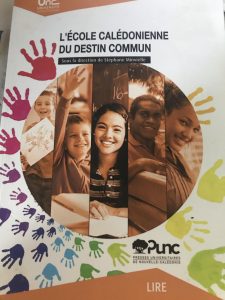
Participation et communication au colloque L’école calédonienne du destin commun à Nouméa en octobre 2016. Cette communication a fait l’objet d’une publication dans les Actes de ce colloque. Vous trouverez les références en bas de pages.

Entre reproduction du modèle national et « autonomie » du pays : Quelques aspects de la gestion de la difficulté scolaire en Polynésie française.
A 18 000 kilomètres de Paris, la Polynésie française est constituée de 118 îles dispersées sur 5 millions de km2maritimes. Elle s’étire sur une surface aussi vaste que l’Europe. En 2012, le dernier recensement comptabilise 268 207 habitants répartis sur l’ensemble des cinq archipels. Cependant 75% des habitants se concentrent sur les îles du vent, dans l’archipel de la société, entre Tahiti et Moorea.
Si l’histoire coloniale qui la lie à la République française ne ressemble pas à celle de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française partage aujourd’hui avec cette collectivité un héritage qui mêle une grande diversité ethnique de sa population et de très fortes inégalités socio-économiques principalement entre quatre communautés : les Polynésiens qui représentaient en 1988, 82 % de la population, les Asiatiques (6%), les Européens ( 11% dont 98% de nationalité française) et les « demis » (issus de mariages mixtes) qui sont également représentés dans les trois premiers groupes ethniques (ITSTAT, 1988).
Ces inégalités ont été mesurées dans un document de travail de l’Agence française de développement (Herrera & Merceron, 2010) intitulé « Les approches de la pauvreté en Polynésie française ». En utilisant l’indice de Gini, ce document constate que la Polynésie française se rapproche davantage des pays latino-américains que de la métropole. En effet, « Les 20% (le quintile) des ménages polynésiens les plus riches capte près de la moitié (47%) du revenu total des ménages, tandis que le quintile des ménages les plus pauvres en reçoit à peine 6%, et que « la pauvreté est nettement plus élevé chez les ménages qui se ressentent « Maohi » (Polynésiens) que chez les « Popa’a » (Européens), cela provient pour l’essentiel de différentiels de niveaux de diplômes et d’insertion sur le marché du travail ».
Comme en Nouvelle-Calédonie, les fonctionnaires mis à disposition par l’Etat font partie des plus favorisés. Ils , bénéficient de traitements indexés qui s’élèvent, en moyenne, à trois fois le salaire minimum polynésien (149 491 fcp soit 1252 euros). Il n’est pas anodin de noter que le niveau de vie dont bénéficie le corps enseignant l’éloigne de factodes conditions dans lesquelles vivent de nombreuses familles polynésiennes.
Il existe également des différences entre les enseignants du premier et du second degré. Les premiers sont quasiment tous recrutés localement, tandis que les seconds sont à 50% des enseignants mis à disposition de la Polynésie française. L’autre moitié bénéficie de la reconnaissance de leur centre d’intérêt moral et matériel (CIMM) sur le territoire, ce qui les protège de la limitation de durée de séjour, qui est égal à deux ans renouvelable une fois en lien avec le décret de 1996.
L’institution scolaire y est pour ainsi dire calquée sur le modèle métropolitain : même organisation des examens mise à disposition d’enseignants du secondaire, diplôme nationaux, etc. Comme en Nouvelle-Calédonie, le système scolaire polynésien a été historiquement construit sur le modèle métropolitain avec une accélération de la mise en conformité de ce système après la Seconde Guerre mondiale (cf. chapitre de Marie Salaün dans ce volume). Par ailleurs, il se caractérise par l’aspect massif des inégalités scolaires, réalité que la plupart des diagnostics institutionnels expliquent par un « retard » de la Polynésie française par rapport à la métropole. Ainsi, le dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes estime-t-il que ses performances scolaires la situent au niveau de celles de la métropole il y a 20 ans (CTC, 2014). Le taux d’accès au baccalauréat général d’une classe d’âge (16, 5 %) est équivalent au niveau métropolitain de 1970.
D’après le recensement de 2012 : « plus de la moitié des enfants de moins de 18 ans vivent dans les familles dont le chef de ménage est employé ou ouvrier, un sur six vit dans une famille de retraité, ou sans activité professionnelle contre moins d’un sur dix en métropole et enfin un enfant sur quatre vit avec un parent cadre ou de profession intermédiaire, contre près d’un sur deux en métropole. »
[1]A l’entrée au collège, 53% des élèves sont issus de CSP défavorisées, une proportion qui atteint 90% dans certains établissements. En 2007, l’archipel a été qualifié par l’Inspection Générale de « vaste zone d’éducation prioritaire » (IGEN, 2007).
Les indicateurs convergent pour attester de l’ampleur de l’échec scolaire. Par exemple, les taux d’illettrisme recensés lors des Journées défense et citoyenneté (JDC anciennement JAPD) sont éloquents : alors qu’en métropole, les difficultés à l’écrit concernent 7 à 8 % de la population, ils se situent entre 40 et 41% en Polynésie française. De même, le nombre de sorties du système scolaire sans diplôme, ni qualification touche environ 2000 élèves, ce qui représente environ 30% des sortants, taux observé en métropole dans les années 80.
Ce taux est très éloigné de l’objectif fixé par la stratégie Lisbonne définie par le Conseil européen (2000) à savoir moins de 10%. Elle se donnait pour mission de réduire le nombre d’abandons et d’augmenter le niveau de qualification de la population en vue de la croissance économique européenne.
Comment peut on expliquer un si grand écart entre deux systèmes éducatifs pourtant structurellement si proches l’un de l’autre ?
Mon analyse propose de mettre au jour les tensions entre la nécessité de se conformer au modèle national et celle de s’adapter à des réalités locales très éloignées de celles pour lesquelles ce modèle a été et continue d’être pensé. Après un bref retour sur l’histoire du système éducatif local et un survol rapide de la littérature académique produite sur la Polynésie française, nous verrons concrètement comment dans le cadre d’un partage de compétences entre l’Etat et le Territoire, une partie de la difficulté scolaire est gérée.
Le système éducatif polynésien
Autant qu’il est possible de le savoir, avant l’arrivée des Européens qui débute à la fin du XVIIIème siècle, des lieux dédiés à la transmission étaient présents dans les villages de chaque district. On y enseignait l’art de la pêche, la rhétorique, la construction des pirogues, ou encore les conduites à tenir sur les marae, espaces sacrés. Ces écoles traditionnelles furent bousculées par l’arrivée des missionnaire protestants anglais de la London Missionary Society(1797) qui évangélisaient dans les langues locales (Peltzer, 1999).
En 1831, on dénombre une trentaine d’écoles missionnaires réparties sur le territoire, principalement sur l’île de Tahiti, les Îles sous-le-vent mais aussi les Australes et les Tuamotus. Par la suite, la France, souhaitant contrer l’influence britannique dans le Pacifique, imposa progressivement un protectorat (1842). Ce statut évolue en annexion (1880), et la Polynésie devient une colonie sous le nom des Etablissement français d’Océanie (EFO).
Une partie de la population, les ressortissants du royaume Pomare, se voit attribuer le bénéfice de la citoyenneté française par l’acte d’annexion. L’autre partie, à peut près équivalente en nombre, est considérée comme « sujets indigènes » de l’empire. Dans les faits, et en l’absence de possibilité d’exercer une véritable souveraineté populaire à partir de 1903, la distinction entre « sujets » et « citoyens » est peu opératoire. Il en va ainsi du domaine scolaire, car si le principe d’obligation est adopté localement en 1897, quinze ans après la métropole, il concerne de fait aussi bien les enfants des « citoyens » que ceux des « indigènes » et n’est que très partiellement respecté, puisqu’on peut estimer qu’à la veille du second conflit mondial, environ le quart de la population ne bénéficie pas de la scolarisation. Le clivage central est en fait celui qui oppose les écoles de la ville de Papeete, où sont scolarisés les enfants des fonctionnaires métropolitains et ceux des familles « demis » les plus fortunées, et qui, dotées d’enseignants français de métropole, appliquent les programmes en vigueur dans l’Hexagone, et le reste de la Polynésie, des districts ruraux de Tahiti aux tréfonds des vallées marquisiennes.
Devenus comme la Nouvelle-Calédonie, Territoire d’Outre mer (TOM) en 1946, les établissements français d’Océanie changent de nom en 1957 pour devenir la Polynésie française. La loi-cadre Deferre de 1956 accorde aux TOM une évolution vers l’autonomie par la création d’un conseil de gouvernement. Par le transfert de l’Etat au Territoire de la compétence de l’enseignement primaire et secondaire ainsi qu’en matière d’enseignements professionnel et technique, les établissements d’enseignements publics deviennent territoriaux.
Cependant l’Etat, à la demande de la représentation élue locale, conserve la compétence pour les programmes d’étude, les examens, les diplôme et la capacité requise pour enseigner. L’enseignement secondaire n’est créé qu’au début des années 1960, à la faveur des besoins des familles française venues travailler pour le Centre d’expérimentations nucléaires. C’est seulement en 1965 que le premier baccalauréat est organisé en Polynésie française.
Par ailleurs, l’Etat soutient la création de structures originale qui n’existe pas en métropole tel que les Centres d’Education aux Technologies adaptées au Développement (CETAD) en 1981.
En 1984, la Polynésie française dispose d’un statut d’autonomie interne puis obtient un statut d’autonomie en 2004, qui qualifie par la loi organique la Polynésie française de « Pays d’Outre-Mer au sein de la République »
Cette collectivité bénéficie donc d’une autonomie de plus en plus en large au niveau scolaire comme nous le montre le tableau, accessible dans les actes du colloque, présentant la répartition interne des compétences de la Polynésie française entre les organes du pays (Lechat & Argentin, 2011).
Après une première publication pionnière en 1975, sous l’égide de la Fédération des œuvres laïques (Barral, 1975), il faut attendre les années 1990 pour que le thème d’un « échec scolaire » des élèves polynésiens suscite l’intérêt.
On trouve tendanciellement deux orientations dans l’étiologie de l’échec scolaire tout comme en Nouvelle Calédonie (Salaün, 2005)
A une analyse que l’on pourrait qualifier de « culturaliste » s’oppose une explication qui met en avant la dimension socioéconomique. On peut éventuellement envisager une troisième orientation puisqu’on observe en surplomb un discours de l’institution scolaire elle-même, qui mêle les deux types d’analyses précités et aboutit au fait que les difficultés scolaires sont régulièrement imputées à des déterminants externes (notamment familiaux) et rarement venant de l’Ecole elle même.
Avec une orientation psychologique, Bertrand Troadec explique que si l’enfant polynésien ne réussit pas, c’est parce qu’il a développé « une cognition polynésienne » différente de celle de l’enfant métropolitain : « l’infériorité chronique de l’enfant tahitien par rapport à la norme occidentale tend à permettre d’affirmer que des conceptions spécifiques de la culture polynésienne résistent au phénomène d’acculturation » (Troadec, 1996, p. 60).
On retrouve ici le type d’analyse que Marie-Joëlle Dardelin a développé pour la Nouvelle Calédonie (1984).
Pour sa part, Bernard Poirine explique, depuis une perspective socio-économique, que cette analyse lui fait minimiser le fait que la compétition scolaire n’est pas vécue de la même façon par tous les élèves polynésiens. Par ailleurs, il insiste davantage sur l’importance des catégories socioprofessionnelles des familles plus que sur leur « appartenance culturelle » ou ethnicité (Poirine, 1996). On est ici proche des analyses développées par Kohler et Wacquant pour la Nouvelle-Calédonie (1985).
Même si cette étiologie de l’échec scolaire est pour partie commune avec celle développée en Nouvelle Calédonie, de par leur histoire, ces deux territoires ne portent pas le même héritage. En effet, là où la Nouvelle-Calédonie a subi une colonie de peuplement et a connu une ségrégation scolaire forte avec des écoles spécifiques pour les indigènes (cf. chapitre de Salaün dans ce volume), les Polynésiens sont toujours restés majoritaires dans la population (80% aujourd’hui), et on a constaté dès les premières décennies de la colonisation l’émergence d’une classe dominante métisse, les Demis. Si elle n’est pas institutionnalisée comme dans la Nouvelle-Calédonie coloniale, la ségrégation scolaire est pourtant une réalité des EFO avec un premier clivage entre les ruraux et les urbains, et un deuxième clivage entre Tahiti et le reste des îles. Cette réalité inscrit le système scolaire dans « une relation duale : celui des élèves des archipels éloignés et celui des élèves des îles de la société » En effet, selon la zone géographique, il existe ou non des établissements du second degré, une répartition selon la densité scolaire a été privilégié. « Lorsque la logique d’implantation confinait à l’absurde, avec des écoles ne comptant qu’une classe de moins de 10 élèves ou des collèges de moins de 200 élèves, a été privilégiée, en substitution, l’organisation d’hébergements et de transports scolaires inter-îles par voies maritime et aérienne. » (CTC, 2014)
Ce déterminisme géographique représente 1,6 % du budget du système éducatif soit 1,053 milliards FCP afin que les élèves puissent bénéficier d’une prise en charge des transports qu’ils soient terrestres, maritimes ou aériens.
La totalité des dépenses du système éducatif polynésien s’élèvent à 65 milliards FCP en 2012 contre 52 milliards FCP en 2004. (CTC,2014)
Dans le cadre des lois d’autonomie qui se succèdent depuis la fin des années 1970, des adaptations, restreintes, ont concerné certaines disciplines scolaires, avec, par exemple, l’introduction dans l’horaire normale des écoles maternelles et primaires (donc à titre obligatoire…) d’un enseignement Langues et culture polynésienne (cf. l’article de Jacques Vernaudon dans ce volume).
D’autres adaptations ont été mises en œuvre comme la création de structures originales afin de répondre au plus près aux difficultés de certains élèves par la création de CETAD ou de CJA.
Ces adaptations, qui concernent l’ensemble des élèves, ne suffisent pas à pallier un déterminisme géographique, lui-même lié au déterminisme social.
La dispersion de l’habitat entre des archipels éloignés les uns des autres s’accompagne, dans un contexte de scolarité obligatoire, de considérables difficultés de transport. Elle engendre également un nomadisme scolaire qui devient une cause d’échec scolaire. Les élèves sont contraints de se déplacer dans la famille élargie ou en internat afin de se rapprocher au plus près des écoles. Les conditions de scolarité de ces élèves sont particulièrement difficiles. Plus la scolarité s’allonge plus le déplacement est long pour les élèves des îles.
Afin de retarder la séparation avec les parents, des groupements d’observations dispersés (GOD) existent, rappelant les classes uniques en métropole, où tous les niveaux sont présents dans une même classe. L’isolement géographique touche également les enseignants, qui, depuis le développement du système scolaire, ne se pressent pas en masse pour demander les affectations les plus éloignées de Tahiti. Cela a pu conduire à recruter des personnels qui ne satisfaisaient pas aux exigences en termes de titres universitaires, environ 30% des enseignants recrutés sans le baccalauréat (CTC, 2014) ; et aujourd’hui encore, certaines circonscriptions héberge un pourcentage très conséquent d’enseignants non titulaires : « cette situation a cependant conduit à maintenir devant les élèves les plus éloignés des exigences scolaires, les enseignants les moins instruits et les moins formés » (CTC 2014).
Le partage des compétences entre l’Etat et le Territoire
La gouvernance du système éducatif polynésien repose sur un mode partenarial entre l’Etat et le territoire régi par la convention du 4 avril 2007 lié à la la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Différentes conventions se sont succédées, avec pour but de notifier la répartition des compétences entre l’Etat et le territoire car les compétences ne sont pas toutes transférées.
Si un statut « d’autonomie » a été reconnu à la Polynésie française en 1984, le transfert de la compétence éducative avait été rendu possible dès 1957 (au primaire) dans un premier temps, puis au secondaire (1987) par la suite. L’Etat reste garant des diplômes nationaux.
En tant que principal financeur, L’Etat, représenté par le Vice-Recteur, met à disposition 92% des moyens humains et matériels afin de répondre au mieux à la Constitution qui prévoit « l’égal accès de l’enfant (et de l’adulte) à l’instruction » sur l’ensemble du territoire de la République. La majorité des enseignants exercent selon le principe d’une Mise à Disposition (MAD) pour la Polynésie française. Ces personnels sont sélectionnés sur dossiers à travers leurs parcours, leurs compétences et sont affectés par le ministre polynésien sur un établissement scolaire territorial. `
Une fois, les candidats sélectionnés, ils ne bénéficient que d’une seule journée de formation afin de contextualiser leurs enseignements. Parfois, cette dernière a lieu alors que certains ne sont pas encore arrivés en Polynésie. L’adaptation se veut rapide avec pour rappel que la loi est la même pour tous, étant donné que la République est une et indivisible. Cependant, exercer en Polynésie française nécessite quelques ajustements pour un fonctionnaire métropolitain, car il existe des différences juridiques entre ces deux systèmes.
En effet, toutes les lois votées en métropole ne sont pas répercutées automatiquement en Polynésie française.Pour ce faire, certaines doivent être adopté par l’assemblée territoriale. I
Les acteurs de la communauté éducative doivent être informés de ces différences d’applications ; e qui est plus facile depuis l’entrée en vigueur du code de l’éducation pour la Polynésie française (2015).
Auparavant, le flou juridique engendrait quelques incompréhensions, comme nous le raconte, Marc Debene, en préface de ce code : « « Ainsi a t’on pu dans certains établissements publics polynésiens rappeler l’interdiction du port des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse alors que la loi du 15 mars 2004 (Art. L. 141-5-1 du Code de l’éducation) n’a pas étendue à la Polynésie française (Art.L.163-1 ne le mentionne pas !). »
En outre, le territoire dispose d’un ministre de l’Education polynésien, et les services de l’éducation se trouvent au sein de la Direction Générale de l’Education et des enseignements (DGEE). Depuis juin 2004, cette nouvelle entité rassemble la Division de l’enseignement secondaire (crée en 1987) et la Division de l’enseignement primaire (crée en 2001) Cette fusion permet la prise en charge de l’entretien des bâtiments scolaires, des bourses, des allocations d’études, du transport avec l’aide des communes mais également des questions relatives au domaine du numérique, de la vie scolaire, de l’orientation et de l’insertion ou encore de l’action pédagogique et éducative.
Cependant concernant le second degré, l’Etat s’est engagé à travers la convention du 4 avril 2007 à participer aux constructions scolaires nécessaire afin de « désengorger » certains établissements qui subissent une surpopulation d’élèves. Un bon exemple est le collège de Taravao situé sur la Presqu’île de Tahiti, soit à 55 kms de Papeete. Il a été conçu pour accueillir entre 600 et 700 élèves et il en reçoit 1300. Après plusieurs faux départs, un nouveau collège est en construction à Mataiea, afin de pouvoir le désengorger ainsi que celui de Papara.
Le pilotage pédagogique est compliqué par l’éloignement de certains IA-IPR, qui résident en Nouvelle-Calédonie. Les inspections se limitent par conséquent à des missions entre 15 et 20 jours, deux à trois fois par an lorsque cela est possible.
La relation partenariale avec l’Etat repose sur une communication, qui a par le passé, parfois fait défaut. En outre, celle-ci a été plusieurs fois conflictuelle suite à un manque de transparence de la part de la collectivité de la Polynésie sur la tenue des comptes. Il n’existe aucun comité de suivi, et par conséquent, il est difficile de chiffrer le bilan des opérations. Comme le souligne la chambre territoriale des comptes « L’opacité des relations financières a mis à mal le fondement du partenariat » (CTC,2014).
Cette relation est également compliquée par ce qui est perçu, depuis la métropole, comme un « manque d’efficience ». Les résultats scolaires ne sont pas à la hauteur des moyens alloués par l’Etat.
« La dépense scolaire par élève était, en 2014, respectivement de 8.223 euros en Polynésie française et de 10.539 euros en Nouvelle-Calédonie, contre 7.700 euros en 2013 (dernier chiffre connu) pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer », constate la cour des comptes (2015) Même si les moyens mis en oeuvre « ont permis des progrès », avec notamment la progression du nombre de bacheliers, « les résultats restent en deçà des références métropolitaines ». Environ 35% des élèves de Polynésie et 20% de ceux de Nouvelle-Calédonie sortent encore du système sans diplôme ni qualification « contre environ 10% en métropole » (CTC, 2015).
Le coût et les performances métropolitaines restent l’étalon à l’aune duquel se mesure le rendement scolaire.Toutefois, l’Etat a cependant accepté certaines adaptations locales, encourageant la création de dispositifs propre à la Polynésie française. L’objectif est de réduire le nombres d’abandons et d’augmenter le niveau de qualifications de la population en vue de la croissance économique, avec la proposition d’un enseignement professionnel dans une structure spécifique à la Polynésie française : les Centres d’éducation aux technologies appropriées au Développement (CETAD) que nous allons maintenant présenter.

Les Centres d’éducation aux technologies appropriées au développement (CETAD)
Les Centres de jeunes adolescents (CJA)
Structures spécifiques ou gestion de la difficulté scolaire ?
Les CETAD sont des structures éducatives professionnelles implantées géographiquement sur le site d’un collège ou d’un lycée. Ils sont donc placés sous l’autorité du chef d’établissement avec un professeur détaché quelques heures pour en assurer la coordination. Tous les collèges ne sont pas pourvus de CETAD. Il en existe 12 réparties sur les cinq archipels, qui scolarisent environ un millier d’élèves. Cette structure ne remplace pas les Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, (SEGPA), qui sont présentes dans certains établissements scolaires du territoire.
Les CETAD ont été crée en 1981 pour former des ouvriers polyvalents semi-qualifiés par l’obtention d’un CAP-D (Certificat d’aptitude au développement), l’objectif étant également de « bien vivre dans les iles éloignés » (CTC, 2014). Ce sont les ateliers complémentaires des collèges qui ont été transformés en ateliers polyvalents. Ils ont été adaptés aux exigences économiques locales et aux conditions sociale et culturelle des adolescents polynésiens. Il s’agissait d’offrir à des élèves éloignés une formation qualifiante nécessaire afin de pouvoir rester dans leurs archipels si tel est leur désir.
En 1983, des filières spécifiques comme la construction et l’entretien des bâtiments (CEB), ainsi que l’activité familiale artisanale et touristiques (AFAT) ont été ouvertes. En 1988, ce sont les filières de gestion et entretien en milieu marin (GEMM) et gestion et entretien de la petite exploitation rurale (GPER) qui viennent compléter l’offre de formation dans les CETAD.
Les élèves y ont accès à la fin de la 5ème, niveau considéré comme un palier d’orientation jusqu’en 2016. A l’origine, le CETAD dispensait deux années de formation, portées aujourd’hui à trois ans après la 5e. A la fin du cursus, les élèves passent le diplôme national du brevet professionnel en vue d’intégrer un lycée professionnel ainsi que CAP-D, qu’ils peuvent utiliser lors de leur entrée dans la vie active.
Cette structure permet aux élèves en difficulté, d’appréhender une autre façon d’apprendre en alliant théorie et pratique, avec pour certains une projection professionnelle.
Malheureusement le recrutement de ces élèves se faisait à partir de leurs difficultés en mathématiques et en français ; ce qui entrainait par la suite un faible taux de réussite aux diplômes du fait de la faiblesse des compétences acquises dans les matières disciplinaires « En effet, sur les élèves de 6èmedécelés avec des difficultés en français et en maths soit environ 50% des élèves, beaucoup, sinon tous intègrent la voie professionnelle ».(p. 93, CTC, 2014).
Par ailleurs, le CETAD a été utilisé pour des élèves en mal de repères, pour lesquels l’enseignement pratique permettait de redonner du sens à une théorie devenue trop abstraite. Ainsi, il a pu remédier à certaines situations d’absentéisme. Ces élèves ne sont pas pour autant sortis de l’enceinte de l’établissement scolaire puisqu’ils bénéficient que les collégiens ou lycéens : même règlement intérieur, sauf en lycée où l’âge entre en ligne de compte, même temps de vie scolaire et d’études partagés, ateliers sur le site du collège ou du lycée. La différence avec le collège se trouve dans la notation, puisqu’elle passe par des codes couleurs se rapprochant davantage de l’évaluation en primaire : vert pour les compétences acquises, rouge pour celles non acquises.
Cette structure a été créée afin de répondre à la scolarisation des élèves des îles et a connu comme dérive de traiter principalement la difficulté scolaire. L’Etat a soutenu ce projet jusqu’à cette année (2016) où par la réforme du collège, le recrutement au CETAD en fin de 5èmeprends fin. Il aura désormais lieu après la 3ème.
Parallèlement à cette structure, le territoire a soutenu la création des Centres de jeunes adolescents (CJA) en 1978. Ils ont d’abord été créés à titre expérimental pour ensuite se multiplier dans les années 80, soit en même temps que les CETAD. Une rivalité est apparue entre ces deux structures. Les CJA ont été accusés de n’apporter aucune valorisation et formation professionnelle contrairement à l’enseignement proposé dans les CETAD, le but recherché n’étant pas le même. Ces structures ont été créées pour répondre à la demande d’occupation des jeunes de 14 ans, non soumis à l’obligation scolaire et ayant échoué au certificat d’études. Leur objectif était de réinsérer ces jeunes souvent en échec par la formation à une économie de subsistance. A travers des formations très genrées, les filles pratiquaient la couture, et la cuisine tandis que les garçons faisaient de l’agriculture et de la mécanique.
Malgré leurs divergences, ces deux structures se complètent et sont devenus des partenaires de la réussite éducative où le jeune redevient acteur de sa scolarité. En parallèle, la plateforme proposée par l’Education Nationale en métropole telle que la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) a connu quelques adaptations mais a le mérite d’exister sur le territoire, au sein de la DGEE. Elle vise à réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans diplôme dès le primaire, et à prendre en charge les élèves décrocheurs (âgés de plus de 16 ans) en vue d’un raccrochage et/ou d’une qualification reconnue, pour une insertion sociale et professionnelle durable.
Cependant la réforme du collège a commencé à transformer le paysage de ces deux structures locales. Du fait d’une réticence des autorités locales à faire disparaître les CETAD par crainte d’une hausse des élèves absentéistes, ils évoluent à la rentrée 2016. La collectivité de la Polynésie rappelle que « la suppression des CETAD aurait des effets catastrophiques immédiats en terme de décrochage scolaire » (CTC 2014).
Le pallier d’orientation en fin de 5èmedisparaît pour laisser place à un recrutement en fin de 3èmece qui rapproche davantage les CETAD des antennes de lycées professionnels existant en Nouvelle-Calédonie. La rénovation de cette structure spécifique à la Polynésie tient également en compte l’évolution du niveau de qualification des élèves. Auparavant le CAP-D n’était pas reconnu par l’Etat au niveau V ce qui contribuait à dire que les élèves de CETAD étaient des décrocheurs au sens même de la loi de 2009, qui concerne « les anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire ».
Aujourd’hui, une question est de savoir quel CAP ces structures vont proposer. Est-il possible de conserver le caractère polyvalent de l’éventail des formations ? L’Etat va-t-il reconnaître ce diplôme ? Quelle différence existe-t-il avec les lycées professionnels ? Des passerelles sont-elles envisageables ou une hiérarchisation des structures va-t-elle s’imposer ? Les structures sont-elles en capacité matérielle de faire face à ce changement et de répondre ainsi aux exigences nationales ? Le diplôme proposé aura t’il une meilleure reconnaissance du CAP-D sur le marché du travail polynésien ?
Le territoire a suivi également la réforme du collège pour inclure davantage les CJA dans le système éducatif polynésien. Ils proposeront désormais différents parcours sous forme de modules adaptés à la difficulté de l’élève dans le but d’une réinsertion dans le système traditionnel classique, se rapprochant ainsi des classes relais en métropole. La réforme du collège va-t-elle pouvoir proposer des temps en ateliers professionnels afin de répondre à la demande de certains élèves d’être davantage en pratique ? Va-t-elle réussir à corriger les carences du primaire comme le soulignait le rapport de la Chambre territoriale des comptes ?
Conclusion
La difficulté scolaire en Polynésie est une réalité, liée à un déterminisme géographique et social mais aussi à son histoire scolaire récente. Historiquement, elle a été contrainte d’adopter le système éducatif métropolitain, au travers des partages de compétences elle a fait le choix de poursuivre sur cette voie avec le maintien des programmes nationaux destiné à atteindre l’objectif la réussite aux diplômes nationaux.
Malgré la crise de l’école en Polynésie française, l’éducation prioritaire n’a pas été un impératif pour le territoire pendant plus de vingt ans. Quelques adaptations locales ont été possibles et l’Etat a soutenu la création de structures originales que sont les CETAD et le CJA. Toutefois faute de résultats convaincants,(le nombre d’élèves ne fait que chuter) l’originalité de ces structures s’estompe avec la mise en œuvre de la réforme du collège applicable en Polynésie française à la rentrée d’août 2016.
Le système éducatif polynésien s’adapte et rénove ces structures afin de favoriser une réussite des élèves polynésiens reconnue au niveau national et répondant par ailleurs, aux exigences européennes. La question est de savoir si ces rénovations vont être l’occasion d’adapter la réforme des collèges au contexte polynésien ?
La valorisation des ateliers au CETAD permettra t’elle d’appliquer les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) ?
Aujourd’hui, le gouvernement semble à l’écoute de la jeunesse, avec par exemple, l’organisation des États généraux ou encore des Assises de la jeunesse (2016). Ces initiatives sont appréciées par les jeunes qui souhaitent participer à l’élaboration de la nouvelle Charte de l’éducation. Ils ont notamment demandé une meilleure valorisation de la culture locale.
Comme dans l’ensemble de l’outre-mer français, l’École est le « produit de la rencontre coloniale » (Salaün, 2013) L’important est donc de trouver un consensus politique grâce auquel elle n’est pas pris en otage, permettant ainsi d’avancer vers un destin commun, celui de la réussite de tous les élèves.